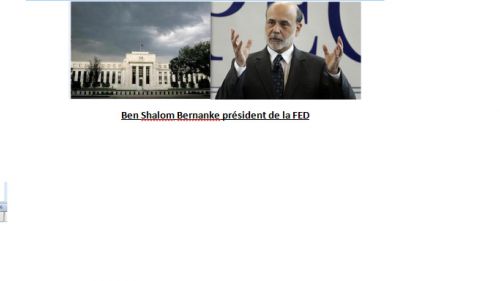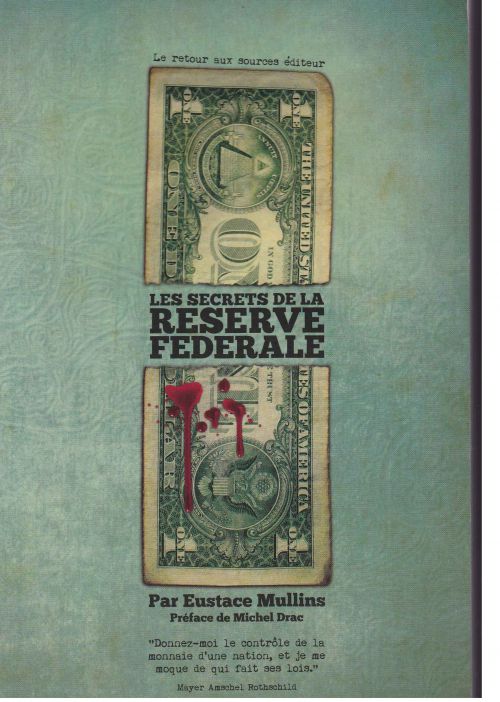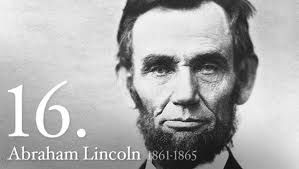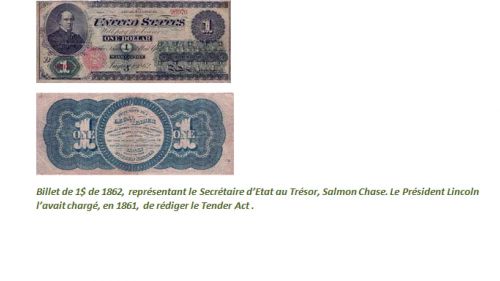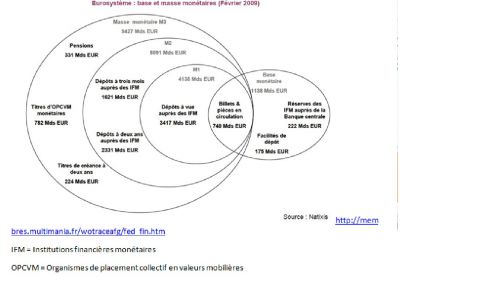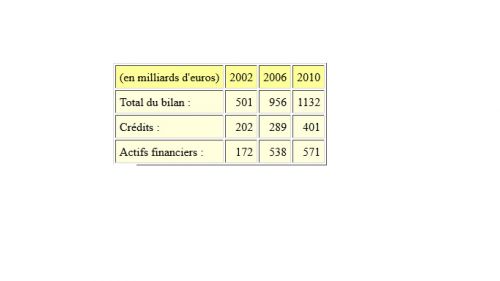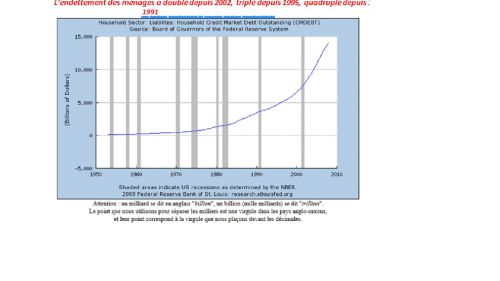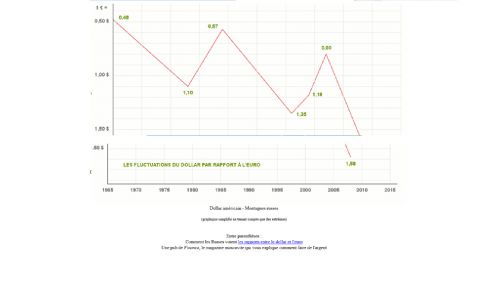LES SECRETS DE LA FED PART1
Le cartel de la FED, les 8 familles (élite financière juive et protestante)
Le contrôle du monde par la mondialisation, le pouvoir de l'argent, de la finance et de la création monnétaire appartient à une élite internationale juive et protestante, c'est un fait indiscutable. Mais tout les juifs et protestants ne sont pas des financiers...
Donc il n'y a pas de mal à en parler, je suis pour la total transparence, contre la langue de bois, et les tabous. Les faits sont les faits et il n'y a pas d'amalgame possible, on a affaire à une élite mondialiste qui se fout éperdument des peuples des nations, des religions,et il ne pense qu'à la domination et au pouvoir. Nous ne sommes que du bétail, des esclaves, tous nous sommes tous concernés, chrétiens d'en bas, musulmans d'en bas, juifs d'en bas, nous avons tous les mêmes ennemis, nous devons nous unir nous peuples d'en bas face à l'oligarchie mondialiste juive et protestante de la finance qui ne représente même pas 1 % de la population mondiale. Nous n'allons pas faire de la propagande anti-juive, mais anti oligarchie financière juive et protestante, nous n'allons pas utiliser les méthodes de manipulation de masse comme le fait la propagande des média-menteur-sioniste pour stigmatiser les musulmans. Nous ne sommes pas aussi con...mais sachez que les médias-menteurs-sionistes n'hésiteront pas à accuser toutes recherches et toutes critiques sur la finance internationale comme étant de l'antisémitisme, mais paradoxalement jamais ne diront que c'est de l'anti-protestantisme.
Nous ne pouvons pas les laisser diriger nos vies à ce point, c'est fini, maintenant c'est fini parce que nous serons de plus en plus nombreux à nous réveiller.
Les quatre cavaliers du sytème bancaire américain (Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup and Wells Fargo) possèdent les quatre cavaliers du pétrole (Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP Amoco et Chevron Texaco) en tandem avec Deutsche Bank, la BNP, Barclays et d’autres anciens pontes européens de l’argent. Mais leur monopole sur l’économie globale ne s’arrête pas aux limites des champs pétroliers.
D’après les déclarations d’entreprise 10K enregistrées avec la SEC (NdT: la commission des cotations boursières, le “shériff” de Wall Street, ou ce qui devrait l’être), les quatre cavaliers de la banque sont parmi les 10 actionnaires majeurs de pratiquement toutes les entreprises figurant dans le ghotta du Fortune 500.
Alors qui sont donc les actionaires de ces banques centralisant l’argent ? Cette information est gardée de manière plus ferme. Mes demandes aux agences régulatrices bancaires concernant la question de savoir qui possède les actions des top 25 compagnies américaines tenant les actions des banques ont initialement reçu un status couvert par le Freedom of Information Act (NDT: loi sur la liberté de l’information, qui aux Etats-Unis prévoit d’empêcher le secret de l’information), avant d’être finalement refusées sous couvert de raisons de “sécurité nationale”. Ceci est très ironique, sachant que bon nombre d’actionnaires résident en Europe.
Un des monument de la richesse de l’oligarchie globale qui possède ces compagnies de holding bancaire est la US Trust Corporation, fondée en 1853 et maintenant propriété de Bank of America. Un des récents directeurs de l’US Trust Corporation et administrateur honoraire était Walter Rothschild. D’autres directeurs furent Daniel Davison de JP Morgan Chase, Richard Tucker d’Exxon Mobil, Daniel Roberts de Citigroup et Marshall Schwartz de Morgan Stanley.
J.W. McCalister, un membre éminent de l’industrie du pétrole avec des entrées dans la maison des Saouds, écrivit dans le Grim Reaper, qu’il a obtenu des informations de banquiers saoudiens, qui citaient le fait que 80% de la banque fédérale de New York, de loin la plus puissante branche de la réserve fédérale, étaient détenus par juste huit familles, dont quatre résident aux Etats-Unis.
Ce sont les familles :
- Goldman Sachs, (élite financière juive ashkénaze)
- Rockefellers, (élite financière protestante)
- Lehmans et (élite financière juive ashkénaze)
- Kuh Loebs de New York, (élite juive ashkénaze)
- les Rothschild de Paris et de Londres, (élite juive ashkénaze)
- les Warburg de Hambourd, (élite juive ashkénaze)
- les Lazards de Paris et, (élite juive askénaze)
- les Israëliens Moses Seifs de Rome. (élite juive ashkénaze)
CPA Thomas D. Schauf confirme les dires de McCallister, ajoutant que 10 banques contrôlent les douze branches de la réserve fédérale.
Il nomme :
- N.M Rothschild de Londres, (banque juive)
- Rotshschild Bank de Berlin, (banque juive)
- la banque Warburg de Hambourg, (banque juive)
- la banque Warburg d’Amsterdam, (banque juive)
- Lehmans Brothers de New York, (banque juive)
- Lazard Brothers de Paris, (banque juive)
- la banque Kuhn Loeb de New York, (banque juive)
- la banque Israel Moses Seif de Rome, (banque juive)
- Goldman Sachs de New York et (banque juive)
- la banque JP Morgan Chase de New York. (banque protestante)
Schauf également cite William Rockefeller, Paul Warburg, Jacob Schiff (élite juive ashkénaze) et James Stillman (élite juive ashkénaze) comme étant les individus qui ont le plus d’actions à titre individuel dans la réserve fédérale.
Les Schiffs sont étroitement liés à Kuhn Loeb, les Stillmans de Citigroup, qui se marrièrent dans le clan Rockefeller au début du siècle.
Eustace Mullins arriva aux même conclusions dans son livre “Les secrets de la réserve fédérale”, dans lequel il montre des diagrammes connectant la Fed et ses banques membres avec les familles Rothschild, Warburg, Rockefeller et autres.
Le contrôle exercé par ces familles sur l’économie globale ne peut pas être exagéré et est couvert volontairement du sceau du secret. Leur bras médiatique est prompt à discréditer toute information exposant ce cartel de banques privées comme étant une “théorie du complot”. Pourtant, les faits demeurent.
La maison Morgan (protestante)
La banque de la réserve fédérale est née en 1913, la même année que mourut J. Pierpont Morgan et que la fondation Rockefeller fut créée. La maison Morgan présidait sur la finance américaine depuis le coin de Wall Street et Broad, agissant déjà en quasi banque centrale américaine depuis 1838, quand Georges Peabody (protestant) la fonda à Londres.
Peabody était un partenaire d’affaires des Rothschilds. En 1952, l’enquêteur sur le Fed Eustace Mulins émit la suposition que les Morgans n’étaient de fait que les agents de Rothschild. Mullins écrivit que les Rothschilds “…préféraient opérer de manière anonyme aux etats-Unis derrière la façade de la JP Morgan and co”.
L’écrivain Gabriel Kolko écrivit “Les activités des Morgan en 1895-96 à vendre des bons du trésor or américains en Europe étaient basées sur une alliance avec la maison Rothschild.”
La pieuvre financière Morgan enroula rapidement ses tentacules autour du monde. Morgan Grenfell opérait depuis Londres. Morgan et Ce depuis Paris. Les cousins des Rothschilds Lambert montèrent Drexel et compagnie à Philadelphie.
La maison des Morgans étaient impliquées avec les Astors, DuPonts, Guggenheims, Vanderbilts et les Rockefellers. Elle finança le lancement de AT&T, de General Motors, General Electric et DuPont. Tout comme les banques de Londres Rothschild et Barings, Morgan devint partie prenante dans la structure de bon nombre de pays.
Dès 1890, la maison Morgan prêtait à la banque centrale d’Egypte, finançait les chemins de fer russes, renflouait les obligations du gouvernememt provincial du Brésil et finançait des travaux publics argentins. Une récession économique en 1893 renforça la puissance financière de Morgan. Cette année là, Morgan sauva les Etats-Unis d’une panique bancaire, formant un groupement pour remonter les réserves fédérales avec un envoi d’une valeur de 62 millions de dollars d’or des Rothschilds.
Morgan fut la force motrice derrière l’expansion occidentale des Etats-Unis, finançant et contrôlant les chemins de fer qui avançaient vers l’Ouest. En 1879 les chemins de fer centraux de New York, financés par Cornelius Vanderbilt-Morgan donnèrent des prix préférentiels à John D. Rockefeller pour son monopole pétrolier de la Standard Oil, scellant ainsi la relation Rockefeller/Morgan.
La maison Morgan alors tombe sous le contrôle familial Rothschild et Rockefeller. Un titre du New York Herald clame “Les géants du chemin de fer forment un trust gigantesque”. J. Pierpont Morgan qui déclara un jour “la compétition est un pêché” se réjouissait maintenant, “pensez un peu que tout le traffic ferrovière en compétition à l’Ouest de St Louis est placé sous le contrôle d’une trentaine d’hommes.”
Morgan et le banquier de d’Edward Harriman Kuhn Loeb obtenaient un monopole sur les chemins de fer, tandis que les dynasties banquières Lehman, Goldman Sachs et Lazard rejoignaient les Rockefellers à contrôler la base industrielle états-unienne.
En 1903, les huit familles établirent le Banker’s Trust. Benjamin Strong du même organisme fut le premier gouverneur de la banque de la réserve fédérale de New York. La création de la réserve fédérale en 1913 fusionna la puissance des huit familles à la puissance militaire et diplomatique du gouvernement américain. Si leurs prêts internationaux n’étaient pas repayés, les oligarques pouvaient maintenant déployer les fusiliers marins américains (NdT: traduction la plus proche pour “US Marines ») pour collecter les dettes. Morgan, Chase et Citibank formèrent une alliance internationale syndiquée de prêteurs sur gage.
La maison Morgan était dans les petits papiers de la maison Windsor britannique et de la maison italienne de Savoie. Les Kuh Loebs, Warburgs, Lehmans, Lazards, Israël Moses Seifs et Goldman Sachs étaient également très proches des maisons royales européennes. Dès 1895, Morgan contrôlait le flot d’or qui entrait et sortait des Etats-Unis. La première vague des fusions américaines étaient dans sa prime enfance et était promue par les banquiers. En 1897, il y eut 69 fusions d’entreprises industrielles. En 1899, il y en eut 1200. En 1904, John Moody, le fondateur de Moody’s Investor Services, dit qu’il était alors impossible de séparer les intérêts des Rockefellers et des Morgans.
La méfiance du public envers l’alliance se propagea. Beaucoup les considéraient comme des traitres à travailler avec le vieux système financier européen. La Standard Oil de Rockefeller, les aciers américains de Andrew Carnegie et les chemins de fer de Edward Harriman étaient tous financés par le banquier Jacob Schiff de Kuhn Loeab, qui lui travaillait en relations étroites avec les Rothschilds d’Europe.
Plusieurs états de l’ouest des Etats-Unis banirent les banquiers. Le populiste William Jennings Bryan fut trois fois le candidat présidentiel démocrate de 1896 à 1908. Le thème central de sa campagne anti-impérialiste fut de dire aux citoyens que les Etats-Unis étaient en train de tomber dans le piège de “l’esclavage financier au capital britannique”. Teddy Roosevelt battît Bryan en 1908, mais fut forcé à la suite de ce feu de brousse anti-impérialiste de faire passer le décret anti-trust. Il s’attaqua ensuite au trust de la la Standard Oil.
En 1912 eurent lieu les auditions Pujo, qui s’occupèrent des concentrations de pouvoir à Wall Street. La même année, Mme Harriman vendît ses parts substantielles de la banque du New York Guaranty Trust à J.P Morgan, créant ainsi Morgan Guaranty Trust. Le juge Louis Brandeis convainquît le présidfent Woodrow Wilson de terminer les situations d’inter-relations de comités directeurs. La loi anti-trust Clayton fut passée en 1914.
Jack Morgan le fils et successeur de J. Piermont, répliqua en demandant aux clients de Morgan Remington et Winchester d’augmenter la production d’armement. Il décida que les Etats-Unis devaient entrer dans la première guerre mondiale. Pressé par la fondation Carnégie et d’autres instances de l’oligarchie, Wilson céda. Comme Charles Tansill écrivit dans “L’Amérique s’en va en guerre”: “Même bien avant que la poudre ne parle, la firme française des frères Rothschild câbla à Morgan and co à New York suggérant le flottement d’un prêt de 100 millions de dollars, dont une partie substantielle serait laissée aux Etats-Unis pour payer les dépenses françaises pour des achats de produits américains.”
La maison Morgan finança la moitié de l’effort de guerre américain, tout en recevant des commissions pour avoir introduit des sous-traitants comme General Electric, DuPont, les aciers Américain, Kennecott et ASARCO. Tous étaient des clients de Morgan. Morgan finança également la guerre des Boers britannique en Afrique du Sud et la guerre franco-prussienne. La conférence de la paix de Paris en 1919 fut présidée par Morgan, qui mena les efforts de reconstruction à la fois de l’Allemagne et des alliés.
Dans les années 1930, le populisme refît surface après que Goldman Sachs, Lehman et autres banques eurent profité du crash de 1929.
Le président du comité bancaire du parlement américain Louis McFadden (démocrate-New York) dit de la grande dépression: “ce ne fut pas un accident. Ce fut planifié… Les banquiers internationaux pensèrent à créer une situation de désespoir afin de pouvoir en émerger comme nos dirigeants absolus.”
Le sénateur Gerald Nye (démocrate-Dakota du nord) présida une enquête sur les munitions en 1936. Nye conclua que la maison Morgan précipita les etats-unis dans la première guerre mondiale pour protéger des emprunts et pour créer un essort de l’industrie de l’armement. Nye produisit plus tard un document dont le titre était “La prochaine guerre”, qui réferrait cyniquement au “truc de le vielle déesse démocratie”, par lequel le Japon pourrait-être dupé dans une seconde guerre mondiale. En 1937, le secrétaire à l’intérieur Harold Ickes, mit en garde de “l’influence des 60 familles américaines”. L’historien Ferdinand Lundberg plus tard écrivit un livre ayant le même titre. Le juge de la cour suprême de justice William O. Douglas décria “l’influence de Morgan… la plus pernicieuse dans la finance et l’industrie aujourd’hui.”
Jack Morgan répondit en rapprochant les Etats-Unis de la seconde guerre mondiale. Morgan avait des relations très étroites avec les familles Iwasaki et Dan, les clans les plus riches du Japon, qui possédaient Mitsubishi et Mitsui respectivement, depuis que ces deux compagnies émergèrent des shogunats du XVIIème siècle. Quand le Japon envahit la Manchourie et massacra les paysans de Nankin, Morgan minimisa l’incident. Morgan avait aussi d’étroites relations avec le fasciste italien Benito Mussolini, tandis que le nazi allemand Dr. Hjalmer Schacht était la liaison entre la banque Morgan et l’allemagne durant la seconde guerre mondiale. Après la guerre, les représentants de Morgan rentrèrent Schacht à la Bank for International Settlements (BIS) à Bâle en Suisse.
La maison Rockefeller
La BIS ( Bank for International Settlements ) est la banque la plus puissante du monde, une banque centrale globale pour les huit familles qui contrôlent les banques centrales de presque toutes la nations occidentales et des pays en voie de développement. Le premier président de la BIS fut le banquier de Rockefeller, Gates McGarrah, un officiel de la Chase Manhattan Bank et de la réserve fédérale. McGarrah était le grand-père de l’ex-directeur de la CIA Richard Helms. Les Rockefellers, tout comme les Morgans, avaient des relations très étroites avec Londres. David Icke écrit dans “Les enfants de la matrix”, que les Rockefellers et les Morgans n’étaient que des “prête-noms” pour les Rothschilds.
La BIS est une propriété de la réserve fédérale, de la banque d’angleterre, de la banque d’italie, banque du canada, banque de suisse, banque de hollande, banque fédérale allemande et la banque de france..
L’historien Carroll Quigley écrivit dans son épique livre “Tragédie et Espoir” que la BIS faisait partie d’un plan, celui de “créer un système mondial de contrôle financier dans des mains privées et capable de dominer le système politique de chaque pays et l’économie du monde dans son entiereté… un contrôle s’exerçant de manière féodale par les banques centrales du monde agissant de concert à travers des accords secrets.” Le gouvernement américain avait une méfiance historique à l’égard de la BIS, et fit pression sans succès pour qu’elle soit abandonnée en 1945 à la conférence de Bretton-Woods. Au contraire de cela, la puissance des huit familles fut exacerbée avec la création par la conférence de Bretton-Woods du FMI et de la banque mondiale. Le banque fédérale américaine ne prit des parts à la BIS qu’en Septembre 1994.
La BIS détient au moins 10% des fonds de réserve d’au moins 80 banques centrales au monde, du FMI et autres institutions multilatérales. Elle sert d’agent financier pour les accords internationaux, collecte les informations sur l’économie globale et sert de prêteur ou de dernier rempart pour éviter un effondrement financier global général. La BIS fait la promotion d’un agenda de fascisme monopolistique capitaliste. Elle donna un prêt de soudure à la Hongrie dans les années 1990 pour assurer la privatisation de l’économie de ce pays. Elle servit de canal de financement d’Adolf Hitler pour les huit familles, emmené par Henry Schroeder des Warburgs et la banque Mendelsohn d’Amsterdam. Un certain nombre de chercheurs assument que la BIS est en fait le centre du blanchiement d’argent du traffic de drogue global.
Ce n’est pas une coïncidence si la BIS a son QG en Suisse, la cache financière préférée pour la richesse de l’aristocratie globale et quartier général de la loge franc-maçonne P2 italienne Alpina et Nazi International. D’autres institutions que contrôlent les huit familles inclues le Forum Economique Mondial (Davos NdT), la Conférence Mnnétaire Internationale et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Bretton Woods fut une aubaine pour les huit familles. Le FMI et la banque mondiale étaient centrales à ce “Nouvel Ordre Mondial”. En 1944, les premiers bons de la banque mondiale furent amenés par Morgan Stanley et la First Boston. La famille française Lazard devint plus impliquée dans les intérêts de la maison Morgan. Lazard Frères, la banque d’investissement la plus importante de France, est la propriété de Lazard et des familles David-Weill, vieille tradition bancaire de Gênes représentée par Michelle Davive. Un directeur récent et PDG de Citigroup fut Sanford Weill.
En 1968, Morgan Guaranty lança Euro-Clear, une banque basée à Bruxelles spécialisée dans le système de négoce des sécurités Eurodollar. Ce fut la première aventure automatique. Certains appelèrent Euro-Clear “la bête”. Bruxelles sert de QG pour la nouvelle banque centrale européenne (BCE) et pour l’OTAN. En 1973, les officiels de Morgan se rencontrèrent secrètement aux Bermudes pour opérer la résurrection illégale de la vieille maison Morgan, 20 ans avant que la loi Glass Steagal fut abandonnée. Morgan et les Rockefeller donnèrent l’apport financier de départ pour Merrill Lynch, la propulsant dans le top 5 des banques d’investissement américaines. Merrill Lynch est maintenant une partie de Bank of America.
John D. Rockefeller utilisa sa richesse du pétrole pour acquérir Equitable Trust, qui avait absorbé plusieurs grandes banques et entreprises dans les années 1920. La grande dépression de 1929 aida Rockefeller à consolider sa puissance. Sa banque Chase, mergea avec la banque de Manhattan de Kuhn Loeb pour former la banque Chase Manhattan, ainsi cimentant une relation familiale de longue durée. Les Kuhn-Loeb avaient financé, avec les Rothschilds, la quête de Rockefeller pour devenir le roi du pétrole. La banque National City Bank de Cleveland donna les fonds à John D. Rockefeller dont il avait besoin pour s’embarquer dans le monopole de l’industrie pétrolière américaine. La banque fut identifiée dans une enquête du congrès comme étant une des trois banques des Rothschilds aux Etats-Unis dans les années 1870; quand John D. créa pour la première fois la Standard Oil dans l’état de l’Ohio.
Un des associés de Rockefeller dans la Standard Oil était Edward Harkness dont la famille fut amenée à contrôler Chemical Bank. Un autre fut James Stillman, dont la famille contrôlait Manufacturers Hanover Trust, Les deux banques ont mergé sous l’ombrelle de JP Morgan Chase. Deux des filles Stillman marièrent deux des fils de William Rockefeller. Les deux familles contrôlent une grosse part de Citigroup également.
Dans les affaires des assurances, les Rockefellers contrôlent Metropolitan Life, Equitable Life, Prudential and New York Life. Les banques de Rockefeller contrôlent 25% de tous les biens des 50 plus grandes banques commerciales des Etats-Unis et 30% de tous les biens des 50 plus grosses compagnies d’assurance aux Etats-Unis.
Les compagnies d’assurance, la première aux Etats-Unis fut créée par les franc-maçons, jouent un rôle important dans la donne de l’argent de la drogue aux Bermudes.
Les entreprises sous contrôle des Rockefeller incluent Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Amoco, Marathon Oil, Freeport McMoran, Quaker Oats, ASARCO, United, Delta, Northwest, ITT, International Harvester, Xerox, Boeing, Westinghouse, Hewlett-Packard, Honeywell, International Paper, Pfizer, Mororola, Monsanto, Union Carbide et General Foods.
La fondation Rockefeller a des liens très étroits avec les fondations Carnegie et Ford. D’autres aventures philanthropiques de la famille incluent le fond des fréres rockefeller, Rockefeller Institute for Medical Research, General Foundation Board, Rockefeller University et l’Université de Chicago, qui vomit régulièrement un flot continue d’économistes d’extrême droite, apologistes du capital international, incluant Milton Friedman.
La famille possède 30 Rockefeller Plaza, où l’arbre de Noël national est allumé chaque année et le Centre Rockefeller. David Rockefeller fut instrumental dans la construction des tours du WTC. La maison de famille des Rockefeller est un complexe dans la partie bourgeoise de New York appelée Pocantico Hills. Ils possèdent également un duplex de 32 pièces sur la 5ème avenue à Manhattan, un manoir à Washington DC, le ranch Monte Sacro au Vénézuéla, des plantations de café en Equateur, plusieurs fermes au Brésil, une grande propriété à Seal Harbor, dans le Maine et des stations balnéaires dans les Caraïbes, Hawaïï et à Porto Rico.
Les familles Dulles et Rockefeller sont cousines. Allen Dulles créa la CIA, assista les nazis, couvra l’assassinat de Kennedy de la commission Warren et fît une alliance avec la confrérie des Frères Musulmans pour créer des assassins conditionnés.
Son frère John Foster Dulles, fut président des trusts bidon de la Goldman Sachs avant l’effondrement de la bourse en 1929 et aida son frère à renverser des gouvernements au Guatémala et en Iran. Tous deux étaient membres de la société secrète Skull & Bones, du Conseil en Relation Etrangère (CFR) et franc-maçons au 33ème degré.
Les Rockefellers furent les instruments pour former le club de Rome et son agenda de dépopulation, dans leur propriété familale de Bellagio en Italie. Leur propriété de Pocantico Hills donna naissance à la Commission Trilatérale. La famille est une pourvoyeuse de fonds importante pour le mouvement eugéniste, qui accoucha d’Hitler, du clonage humain et de la forme courante d’obsession génétique sur l’ADN qui court dans les cercles scientifiques américains.
John Rockefeller Junior fut à la tête du conseil de la population jusqu’à sa mort.
Son fils du même nom est un sénateur élu pour la Virginie de l’Ouest. Son frère Winthrop Rockefeller fut lieutenant gouverneur d’Arkansas et demeure l’homme le plus puissant de cet état. Dans une interview avec le magazine Playboy en Octobre 1975, le Vice-président Nelson Rockefeller, qui était aussi gouverneur de l’état de New York, articula les vues globalistes et arrogantes de sa famille de cette façon: “Je crois absolument dans une planification mondiale totale de l’économie, des affaires sociales, de la politique, de l’armée…”
Mais de tous les frères Rockefeller, c’est le fondateur de la commission trilatérale et président de la banque Chase Manhattan David qui propulsa l’agenda fasciste de la famille sur la scène globale. Il défendît le Shah d’Iran, le régime d’apartheid d’Afrique du Sud, et la junte militaire de Pinochet au Chili. Il fut le plus grand financier du CFR, de la commission trilatérale et (pendant la guerre du Vietnam), du comité pour une paix effective et durable en Asie, une aventure affairiste pour ceux qui faisaient leur argent et vivaient du conflit.
Nixon lui proposa d’être son secrétaire au trésor (ministre des finances, NdT), mais Rockefeller déclina l’offre, sachant que sa puissance était bien supérieure en étant à la tête de la banque Chase Manhattan. L’écrivain Gary Allen écrivit dans son livre “Le dossier Rockefeller” en 1973: “David Rockefeller a rencontré 27 chefs d’état, incluant les dirigerants de la Chine et de l’URSS.”
En 1975, après Le coup de la Nugan Hand Bank et de la CIA contre le premier ministre australien Gough Whitlam, son successeur nommé par la couronne britannique se dépêcha d’aller aux Etats-Unis où il rencontra Gerald Ford après avoir rencontré David Rockefeller.
Article original en anglais : The Federal Reserve Cartel: The Eight Families, publié le 1er juin 2011.
"Le complot de la réserve fédérale américaine" Antony C.Sutton
« Je crois que des institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos privilèges que des armées institutionnelles. Déjà ils ont élevé au sommet une riche aristocratie qui a défié le gouvernement. Le pouvoir d’émission devrait être pris aux banques et redonné au peuple à qui il appartient.Si les Américains permettent un jour aux banques de contrôler l’émission de leur monnaie, d’abord par l’inflation et ensuite par la déflation, les banques et les sociétés qui grandiront autour d’eux priveront le peuple de toute propriété jusqu’à ce que leurs enfants se réveillent sans abri sur le continent de leurs pères. »
Thomas Jefferson
Les secrets de la “FED”, la banque fédérale américaine.
La “fed”, ce mot qui résume tout, la crise, la situation mondiale, les magouilles à Wall Street, le cours de l’or et de l’argent, la valeur décroissante du dollar…Nous allons parler de la banque fédérale américaine qui n’est fédérale que de nom et qui est la plus grosse trahison jamais faite aux États-Unis. Trahison… Le mot peut surprendre mais lorsque les pères fondateurs des États-Unis sont venus sur le continent américain, c’était pour fuir principalement le système bancaire anglais qui disposait d’une banque centrale, ils ont alors décidé de créer une nation dans laquelle il n’y aurait jamais de banque centrale, et un jour, la “fed” est apparue. Elle est même suspectée de l’assassinat de JFK qui voulait dénoncer cela. Autre fait marquant, Ben Bernanke il n’y a pas longtemps à refusé un audit de Fort Knox arguant que s’il autorisait un tel audit, cela mettrait la sécurité nationale en danger. Bref, même à Fort Knox, il n’y a plus rien, et encore moins d’or, fini, plus rien, kapout!
Bref, il y a beaucoup à dire et à apprendre sur cette banque obscure qui s’est bien gardée de toute grosse publicité et qui pourtant est à l’origine d’une des plus grosses crises que la planète ait jamais connue, et c’est le reportage que je vous met à disposition qui va répondre à la plupart de vos questions.
Mais rendons auparavant à César ce qui revient à César, je vous met ici la présentation faite par l’auteur du billet qui m’a permis de découvrir ce reportage passionnant.
La plupart des gens, aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, pensent que les dollars en circulation sont créés par le gouvernement américain. Que le nom de « Réserve Fédérale », mentionné sur chaque billet, désigne une administration gouvernementale. Or, il n’en est rien : la « Réserve Fédérale » est une institution privée, possédée par des banques commerciales.
Le livre d’Eustace Mullins, Les secrets de la réserve fédérale, traduit pour la première fois en français, a représenté quarante années de travail pour son auteur. C’est probablement un des ouvrages les plus importants du XX° siècle. C’est le seul livre brûlé en autodafé, par décision de justice, en Europe après 1945. C’est une enquête minutieuse, servie par l’honnêteté et la compétence. C’est, aussi et surtout, une révélation sur la manière dont fonctionne réellement le monde, depuis un siècle.
Dans ce livre, vous apprendrez, entre autres choses, que : Le système de Réserve Fédérale n’est pas fédéral. En outre, il ne possède pas les moindres réserves. C’est un syndicat de l’émission monétaire, dont les membres se sont octroyé le privilège exorbitant de fabriquer l’argent que vous gagnez durement. Sans ce système, il est très probable que les deux guerres mondiales n’auraient pu être déclenchées, ni financées.
Et surtout, vous apprendrez que, pour citer Henri Ford, un grand capitaine d’industrie et un VRAI américain : « L’unique objectif de ces financiers est le contrôle du monde par la création de dettes inextinguibles. » Des mots qui, à l’heure actuelle, prennent une actualité brûlante…
Lire un extrait du livre Les secrets de la réserve fédérale
Mais rendons auparavant à César ce qui revient à César, je vous met ici la présentation faite par l’auteur du billet qui m’a permis de découvrir ce reportage passionnant.
La plupart des gens, aux États-Unis, en Europe et dans le reste du monde, pensent que les dollars en circulation sont créés par le gouvernement américain. Que le nom de « Réserve Fédérale », mentionné sur chaque billet, désigne une administration gouvernementale. Or, il n’en est rien : la « Réserve Fédérale » est une institution privée, possédée par des banques commerciales.
Le livre d’Eustace Mullins, Les secrets de la réserve fédérale, traduit pour la première fois en français, a représenté quarante années de travail pour son auteur. C’est probablement un des ouvrages les plus importants du XX° siècle. C’est le seul livre brûlé en autodafé, par décision de justice, en Europe après 1945. C’est une enquête minutieuse, servie par l’honnêteté et la compétence. C’est, aussi et surtout, une révélation sur la manière dont fonctionne réellement le monde, depuis un siècle.
Dans ce livre, vous apprendrez, entre autres choses, que : Le système de Réserve Fédérale n’est pas fédéral. En outre, il ne possède pas les moindres réserves. C’est un syndicat de l’émission monétaire, dont les membres se sont octroyé le privilège exorbitant de fabriquer l’argent que vous gagnez durement. Sans ce système, il est très probable que les deux guerres mondiales n’auraient pu être déclenchées, ni financées.
Et surtout, vous apprendrez que, pour citer Henri Ford, un grand capitaine d’industrie et un VRAI américain : « L’unique objectif de ces financiers est le contrôle du monde par la création de dettes inextinguibles. » Des mots qui, à l’heure actuelle, prennent une actualité brûlante…
Lire un extrait du livre Les secrets de la réserve fédérale:
"Le livre le plus important jamais écrit pour comprendre comment l'oligarchie bancaire domine le monde."
— Alain Soral
"Des choses, j’en ai appris en abondance en lisant « Les secrets de la Réserve fédérale » !"
— Guillaume de Thieulloy
La plupart des gens, aux Etats-Unis, en Europe et dans le reste du monde, pensent que les dollars en circulation sont créés par le gouvernement américain. Que le nom de « Réserve Fédérale », mentionné sur chaque billet, désigne une administration gouvernementale. Or, il n’en est rien : la « Réserve Fédérale » est une institution privée, possédée par des banques commerciales.
Ce livre, traduit pour la première fois en français, a représenté quarante années de travail pour son auteur. C’est probablement un des ouvrages les plus importants du XX° siècle. C’est le seul livre brûlé en autodafé, par décision de justice, en Europe après 1945. C’est une enquête minutieuse, servie par l’honnêteté et la compétence. C’est, aussi et surtout, une révélation sur la manière dont fonctionne réellement le monde, depuis un siècle.
Dans ce livre, vous apprendrez, entre autres choses, que : Le système de Réserve Fédérale n’est pas fédéral. En outre, il ne possède pas les moindres réserves. C’est un syndicat de l’émission monétaire, dont les membres se sont octroyé le privilège exorbitant de fabriquer l’argent que vous gagnez durement. Sans ce système, il est très probable que les deux guerres mondiales n’auraient pu être déclenchées, ni financées.
Et surtout, vous apprendrez que, pour citer Henri Ford, un grand capitaine d’industrie et un VRAI américain : « L’unique objectif de ces financiers est le contrôle du monde par la création de dettes inextinguibles. » Des mots qui, à l’heure actuelle, prennent une actualité brûlante…
Table des Matières
Préface de Michel Drac
Avant-propos de l’auteur
Introduction
Chapitre I - Jekyll Island
Chapitre II - Le Plan Aldrich
Chapitre III - The Federal Reserve Act
Chapitre IV - Le Comité Consultatif Fédéral
Chapitre V - La Maison de Rothschild
Chapitre VI - La Connexion Londonienne
Chapitre VII - La Connexion Hitlérienne
Chapitre VIII - La Première Guerre Mondiale
Chapitre IX - La Crise Agricole
Chapitre X - Les Créateurs de Monnaie
Chapitre XI - Lord Montagu Norman
Chapitre XII - La Grande Dépression
Chapitre XIII - Les Années 30
Chapitre XIV - Exposé Parlementaire
Addenda
Appendice 1
Biographies
Bibliographie
Extrait
En cette soirée du 22 novembre 1910, un groupe de journalistes se trouvait à la gare de Hoboken, dans le New Jersey. Ils avaient la mine déconfite. Ils venaient juste de voir une délégation constituée des financiers les plus importants du pays quitter la gare en mission secrète. Cela se passait de nombreuses années avant qu’ils découvrissent en quoi consistait cette mission ; et, même lorsqu’ils le surent, ils ne comprirent pas que l’histoire des Etats-Unis avait subi un changement drastique après cette nuit-là à Hoboken.
La délégation était partie dans une voiture de chemin de fer hermétiquement fermée, rideaux baissés, pour une destination non divulguée. Le Sénateur Nelson Aldrich, le chef de la Commission Monétaire Nationale, conduisait cette délégation. Deux ans plus tôt, en 1908, après la panique tragique de 1907 qui déclencha un tollé général pour que le système monétaire de la nation soit stabilisé, le Président Théodore Roosevelt avait promulgué la loi qui allait créer la Commission Monétaire Nationale. Aldrich, lui, avait emmené les membres de la commission dans une tournée européenne de deux ans, dépensant quelques trois cent mille dollars d’argent public. Il n’avait pas encore établi le compte-rendu de ce voyage et il n’avait pas non plus proposé le moindre projet pour une réforme bancaire.
À la gare de Hoboken, le Sénateur Aldrich était accompagné de son secrétaire particulier, Shelton, d’A. Piatt Andrew, le Secrétaire-adjoint au Trésor et assistant spécial de la Commission Monétaire Nationale, de Frank Vanderlip, le président de la National City Bank of New York, d’Henry P. Davison, l’associé principal de J.P. Morgan Company et généralement considéré comme l’émissaire personnel de Morgan, et de Charles D. Norton, le président de la First National Bank of New York dominée par Morgan. Juste avant le départ du train, le groupe fut rejoint par Benjamin Strong, connu aussi pour être un lieutenant de J.P. Morgan, et par Paul Warburg, un récent immigré d’Allemagne qui avait rejoint la maison bancaire Kuhn, Loeb & Co. à New York, en tant qu’associé rémunéré cinq cent mille dollars par an.
Six ans plus tard, l’auteur financier Bertie Charles Forbes, qui fonda par la suite le magazine Forbes (l’éditeur actuel, Malcom Forbes , est son fils), écrivait : “Imaginez un groupe constitué des plus grands banquiers de la nation quittant subrepticement New York dans un train privé. Cachés par l’obscurité, ils sont partis à toute allure, furtivement, à des centaines de kilomètres au sud. Ils se sont embarqués sur une vedette mystérieuse, se sont faufilés sur une île désertée de tous, sauf de quelques serviteurs, et ont vécu là toute une semaine dans un secret si rigide que pas un seul de leurs noms ne fut mentionné une seule fois, de peur que les serviteurs n’apprennent leur identité et rapportent au monde cette expédition des plus étranges et hautement secrète dans l’histoire de la finance américaine. Ceci n’est pas une fiction : je livre au monde entier, pour la première fois, la véritable histoire sur la manière dont le célèbre rapport monétaire d’Aldrich, la fondation du système monétaire actuel des Etats-Unis, fut écrit.
“Le secret le plus total fut prescrit à tous. En aucun cas le public ne devait glaner le moindre indice sur ce qui allait être accompli. Le Sénateur Aldrich avait intimé à chacun de se rendre discrètement dans un wagon privé que la compagnie de chemin de fer avait reçu l’ordre de tracter vers un quai non-fréquenté. Le groupe est parti au loin. Les reporters new-yorkais omniprésents avaient été déjoués…
“Nelson Aldrich avait confié à Henry, Frank, Paul et Piatt qu’il allait les garder enfermés à Jekyll Island, loin du reste du monde, jusqu’à ce qu’ils aient mis au point et rédigé un système monétaire scientifique pour les Etats-Unis. Ce fut la véritable naissance du Système de la Réserve Fédérale actuel, projet établi à Jekyll Island dans une conférence avec Paul, Frank et Henry […] Warburg est le lien qui unit le système d’Aldrich au système actuel. Lui, plus que tout autre, a rendu ce système possible, devenu une réalité qui fonctionne.”
Voici ce qui est exposé dans la biographie officielle du Sénateur Nelson Aldrich :
“En automne 1910, six hommes s’en allèrent chasser le canard : Aldrich, son secrétaire Shelton, Andrews, Davison, Vanderlip et Warburg. Des journalistes attendaient à la gare de Brunswick, en Géorgie. M. Davison alla les voir et leur parla. Les journalistes se dispersèrent et le secret de cet étrange voyage ne fut pas divulgué. M. Aldrich lui demanda comment il avait réussi ce tour de force et ce dernier ne fournit pas spontanément cette information.”
Davison avait l’excellente réputation d’être quelqu’un qui pouvait concilier des factions en guerre, un rôle qu’il avait accompli pour J.P. Morgan durant le règlement de la Panique Monétaire de 1907. Un autre associé de Morgan, T.W. Lamont, a déclaré :
“Henry P. Davison a servi de médiateur dans l’expédition de Jekyll Island.”
À partir de ces références, il est possible de reconstituer cette histoire. Le wagon privé d’Aldrich qui avait quitté la gare de Hoboken tous rideaux baissés emmenait ces financiers à Jekyll Island, en Géorgie. Quelques années auparavant, un groupe très exclusif de millionnaires, emmenés par J.P. Morgan, avait acheté cette île comme lieu de retraite pour l’hiver. Ils s’étaient baptisés « Le Club de Chasse de Jekyll Island » et, au départ, ils utilisaient cette île uniquement pour des expéditions de chasse, jusqu’à ce que les millionnaires réalisent que son climat agréable offrait une retraite clémente contre la rigueur des hivers new-yorkais. Ils commencèrent donc à construire de splendides demeures qu’ils appelaient « chaumières » pour les vacances d’hiver de leurs familles. Le bâtiment du club lui-même, plutôt isolé, était parfois réservé à des sorties entre hommes ou autres activités n’ayant rien à voir avec la chasse. En de telles occasions, il était demandé aux membres du club qui n’étaient pas invités à ces sorties spécifiques de ne pas y venir pendant un certain nombre de jours. Avant que le groupe de Nelson Aldrich ne quittât New York, les membres du club avaient été avertis que celui-ci serait occupé pendant les deux prochaines semaines.
Le Club de Jekyll Island fut choisi comme lieu pour élaborer le projet destiné à contrôler l’argent et le crédit du peuple des Etats-Unis, non seulement à cause de son isolement, mais aussi parce que c’était le lieu de la chasse privée de ceux qui élaboraient ce projet. Plus tard, le 3 mai 1931, le New York Times nota dans une chronique funéraire après la mort de George F. Baker, l’un des plus proches associés de J.P. Morgan, “le Club de Jekyll Island a perdu l’un de ses membres les plus distingués. Un-sixième de la richesse totale du monde était représentée par les membres du Club de Jekyll Island”. La qualité de membre était exclusivement héréditaire.
Le groupe d’Aldrich ne s’intéressait pas à la chasse. Jekyll Island fut choisie comme site pour la préparation de la banque centrale, parce qu’elle offrait une intimité totale et qu’il n’y avait aucun journaliste à quatre-vingts kilomètres à la ronde. Le besoin de secret était tel que les membres de la délégation ont accepté, avant d’arriver à Jekyll Island, qu’aucun nom de famille ne fût prononcé à quelque moment que ce soit durant leur séjour de deux semaines. Plus tard, lorsqu’ils parlaient d’eux-mêmes, les membres du groupe se référaient au Club des Prénoms, puisque les noms de Warburg, Strong, Vanderlip et des autres avaient été prohibés durant leur séjour. Les domestiques habituels se virent offrir par le club deux semaines de vacances, et l’on fit venir du continent, pour cette occasion, de nouveaux serviteurs qui ne connaissaient pas les noms des personnes présentes. Même s’ils avaient été interrogés après le retour de la délégation d’Aldrich à New York, ils n’auraient pu livrer aucun nom. Cet arrangement s’avéra si satisfaisant que les membres, limités à ceux qui avaient été réellement présents à Jekyll Island, tinrent plus tard un certain nombre de petites rencontres informelles à New York.
Pourquoi tout ce secret ? Pourquoi ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres dans un wagon de chemin de fer privé vers un club de chasse isolé ? Apparemment, c’était pour accomplir un programme de service public, afin de préparer la réforme bancaire qui offrirait un avantage précieux au peuple des Etats-Unis et qui avait été commandée par la Commission Monétaire Nationale. D’ordinaire, les participants n’étaient pas opposés à ce que publicité soit faite de leur générosité. En général, leurs noms étaient inscrits sur des plaques de bronze ou à l’extérieur des immeubles qu’ils avaient offerts. Ce ne fut pas la procédure qu’ils suivirent à Jekyll Island. Aucune plaque de bronze n’a jamais été érigée pour marquer les actions désintéressées de ceux qui se rencontrèrent en 1910 à leur club de chasse privé pour améliorer le sort de tous les citoyens des Etats-Unis.
En fait, aucun désintéressement ne se produisit à Jekyll Island. Le groupe d’Aldrich y a séjourné à titre privé pour écrire la législation bancaire et monétaire que la Commission Monétaire Nationale avait reçu l’ordre de préparer en public. Le futur contrôle de la monnaie et du crédit des Etats-Unis était en jeu. Si jamais une véritable réforme monétaire avait été préparée et présentée au Congrès, elle aurait mit fin au pouvoir des créateurs élitistes de l’unique monnaie mondiale. Jekyll Island permit que la banque centrale qui serait établie aux Etats-Unis donnât à ces banquiers tout ce qu’ils avaient toujours désiré.
Comme il était le plus compétent sur le plan technique parmi les présents, Paul Warburg fut chargé de réaliser la plus grande partie de la conception de ce projet. Son travail était ensuite discuté et passé en revue par le reste du groupe. Le Sénateur Nelson Aldrich était là pour s’assurer que le projet, une fois achevé, sortirait sous une forme qu’il pourrait faire voter par le Congrès, et les autres banquiers étaient là pour inclure tous les détails nécessaires afin d’être sûrs d’obtenir tout ce qu’ils voulaient dans un avant-projet complet composé au cours d’un seul séjour. Après leur retour à New York, il ne pouvait y avoir de deuxième réunion pour retravailler sur leur projet. Ils ne pouvaient espérer un tel secret pour leurs travaux lors d’un deuxième voyage.
Le groupe de Jekyll Island séjourna au club pendant neuf jours, travaillant avec acharnement afin de mener sa tâche à bien. Malgré les intérêts communs de ceux qui étaient présents, ce travail ne se fit pas sans frictions. Le Sénateur Aldrich, perpétuel dominateur, se considérait comme le leader naturel du groupe et il ne put s’empêcher de donner des ordres à tout le monde. En tant que seul membre non-banquier professionnel, Aldrich se sentait aussi quelque peu mal à l’aise. Il avait eu des intérêts bancaires importants durant toute sa carrière, mais seulement en tant qu’actionnaire tirant profit des actions bancaires qu’il possédait. Il ne connaissait pas grand chose aux aspects techniques des opérations financières. Tout à son opposé, Paul Warburg pensait que chaque question soulevée par le groupe nécessitait un cours et non une simple réponse. Il perdit rarement une occasion de faire un long discours aux membres, dans le but de les impressionner par l’étendue de sa connaissance des opérations bancaires. Les autres en prirent ombrage et Aldrich fit d’acerbes commentaires. Le sens inné de la diplomatie dont était pourvu Henry P. Davison s’avéra être le catalyseur qui les maintint au travail. Le fort accent étranger de Warburg leur écorchait les oreilles et leur rappelait constamment qu’ils devaient accepter sa présence si un projet de banque centrale devait être inventé, qui leur garantît leurs futurs profits. Warburg fit peu d’efforts pour atténuer leurs préjugés et les contesta à chaque occasion possible sur les questions techniques bancaires, qu’il considérait comme sa chasse-gardée.
“Dans toute conspiration il faut conserver un très grand secret.”
Le projet de « réforme monétaire » préparé à Jekyll Island devait être présenté au Congrès comme un travail réalisé par la Commission Monétaire Nationale. Il était impératif que les véritables auteurs de cette loi restent cachés. Depuis la panique de 1907, le ressentiment populaire contre les banquiers était tel qu’aucun parlementaire n’aurait osé voter pour une loi portant la marque de Wall Street, peu importe celui qui avait contribué à ses dépenses de campagne électorale. Le projet de Jekyll Island était un projet de banque centrale et, aux USA, il y avait une longue tradition de lutte contre le fait d’imposer une banque centrale aux citoyens. Cela avait commencé avec le combat de Thomas Jefferson contre le projet d’Alexander Hamilton, soutenu par James Rothschild, pour créer la Première Banque des Etats-Unis. Ce combat s’était poursuivi avec la guerre victorieuse que le Président Andrew Jackson avait livrée contre le projet d’Alexander Hamilton pour une Deuxième Banque des Etats-Unis, dans lequel Nicholas Biddle agissait en tant qu’agent de James Rothschild de Paris. Le résultat de ce combat fut la création de l’Independent Sub-Treasury System, qui gardait les fonds des Etats-Unis soi-disant hors de portée des financiers. Une étude sur les paniques de 1873, 1893 et 1907 indique que celles-ci furent la conséquence des opérations des banquiers internationaux de Londres. Le public exigea en 1908 que le Congrès promulguât une loi afin de prévenir la réapparition de paniques monétaires artificiellement provoquées. Une telle réforme monétaire semblait alors inévitable. C’était pour barrer la route à ce genre de réforme et pour la contrôler que la Commission Monétaire Nationale avait été créée, avec Nelson Aldrich à sa tête, puisqu’il était le chef de la majorité [républicaine] au Sénat.
Le principal problème, ainsi que Paul Warburg en avait informé ses collègues, était d’éviter le nom de « Banque Centrale ». Pour cette raison, la dénomination qu’ils choisirent fut celle de "Federal Reserve System". Ceci tromperait les gens et les inciterait à penser qu’il ne s’agissait pas d’une banque centrale. Toutefois, le projet de Jekyll Island était bien celui d’une banque centrale, remplissant les fonctions principales d’une banque centrale ; elle serait possédée par des personnes privées qui tireraient profit de la propriété de ses actions. En tant que banque émettrice, elle contrôlerait la monnaie et le crédit de la nation.
[...]
Naissance de la Fed
Long mais interessant
- 1 - La conspiration de l’Ile Jekyll
- 2 - La liste des conspirateurs
- 3 - La préhistoire du système monétaire : de la déclaration d’indépendance à la crise de 1907
- 4 - John Fitzgerald Kennedy et la nouvelle tentative de réforme monétaire
- 5 - Les crises monétaires successives aux USA: 1869 - 1873 - 1893 - 1901 - 1907
- 6 - Les préparatifs du coup d’Etat constitutionnel
- 7 - Histoire de l’Histoire de la révélation au public du système de la Réserve Fédérale
- 8 - Ezra Pound et son combat contre l’usurocratie
- 9 - Le mécanisme de l’escroquerie de la Réserve Fédérale
1 - La conspiration de l’île Jekyll
Le 22 novembre de l’année 1910, le luxueux wagon privé du richissime sénateur Nelson Aldrich a été accroché au train qui reliait New-York au sud des Etats-Unis et quelques personnes s’embarquent en direction de la Georgie .
Le voyage durera deux jours et deux nuits et les occupants de ce wagon affecteront, avec une ostentation puérile, de ne pas se connaître bien que leur long périple ait le même but : la chasse au canard sur une petite île située à quelques encablures des côtes de Georgie , l’île de Jekyll .
Notre groupe voyage sous des noms d’emprunts. Les participants avaient fait preuve de ruses de Sioux afin de ne pas se croiser avant l’ébranlement du convoi et s’étaient interdit de se nommer en s’adressant la parole - ou de n’utiliser que leurs prénoms - durant le temps que dura le voyage, tellement leur méfiance était grande et s’étendait au personnel de service . Un incognito total devait être préservé. L’un d’entre eux, qui n’avait jamais chassé de sa vie, portait même un grand fusil sur l’épaule afin de compléter le réalisme naïf du tableau.
Ces personnages, qui se comportaient de manière aussi étrange, représentaient pourtant à eux seuls le quart de la richesse planétaire de l’époque.
La description de l’embarquement et du voyage figure dans les ouvrages des auteurs qui rapportent cette scène, notamment dans celui, très détaillé, d’Eustace Mullins, Secrets of the Federal Reserve, The London Connection, dont je parlerai plus loin (2). Comme les voyageurs occupaient un wagon privé - donc soustrait par définition aux regards du public - les précautions des participants semblent pour le moins excessives , à moins que tel Monsieur Le Trouadec saisi par la débauche , nos sévères banquiers se soient livrés à un moment de détente ludique, avant de se concentrer sur le beau coup financier qu’ils étaient sur le point de monter.
2 - La liste des conspirateurs
Etaient présents:
- Le propriétaire du wagon qui roulait, tous rideaux baissés, vers son destin et vers le nôtre, le Sénateur Nelson Aldrich accompagné de son secrétaire privé, Shelton. Président de la National Monetary Commission (Commission Monétaire Nationale) créée en 1908 et entérinée par le le Président Théodore Roosevelt à la suite de la panique monétaire de 1907 qui succédait à plusieurs autres catastrophes boursières, il était l’aiguillon et l’organisateur de la réunion
Le Sénateur entretenait des relations commerciales étroites avec l’influent homme d’affaires et banquier, John Pierpont Morgan, beau-père de John D. Rockefeller et grand-père de Nelson Rockefeller, un ancien vice-président des États-Unis. Celui-ci n’était pas physiquement présent, mais triplement représenté, il marqua la réunion de son empreinte. Au Congrès, le Sénateur Aldrich passait pour être le porte-parole du banquier J.P.Morgan , lequel représentait également les intérêts des Rothschild d’Angleterre.
Les représentants directs de John Pierpont Morgan étaient:
- Henry Davison, associé principal de la John Pierpont Morgan Company et considéré comme son émissaire personnel.
- Charles Norton, président de la First National Bank de New York, dominée par J.P. Morgan Company.
- Benjamin Strong, le directeur général de la J. P. Morgan’s Bankers Trust Company, et connu pour être également un lieutenant de J.P. Morgan. Il devint d’ailleurs le P.D.G. de la banque, trois ans plus tard, à la suite à l’adoption de la Loi sur la Réserve fédérale. Ces deux banquiers représentaient , eux aussi, les intérêts des Rothschild.
- Il semble qu’il y ait eu quelques autres “invités” dont les noms ne sont, pour l’instant , pas connus et peut-être ne le seront-ils jamais. Ainsi, lorsque George F. Baker, un des associés les plus proches de JP Morgan, mourut le 3 mai 1931, le New-York Times écrivit : “Le club de l’Ile Jekyll a perdu un de ses membres les plus distingués”.
Etait également présent, Frank Vanderlip, le président de la National Bank de New York, la plus grande et la plus puissante banque d’Amérique. Il représentait les intérêts financiers de William Rockefeller et de la société d’investissement internationale Kuhn, Loeb and Company.
Contrairement à ce laissent entendre ceux qui affirment qu’il se serait agi d’un “complot des seuls banquiers”, le gouvernement n’était pas étranger à cette réunion. Il était représenté par A. Piatt Andrew, Secrétaire adjoint du Trésor et Aide Spécial de la National Monetary Commission. Je reviendrai sur cette Commission que le Congrès avait officiellement chargée, en 1907, de préparer une réforme monétaire . D’ailleurs, les défenseurs du système de la FED se fondent sur son existence et sur la présence du représentant du gouvernement à l’Ile Jekyll pour dénoncer comme “complotistes” les critiques de la réunion de l’île Jekyll en omettant sciemment de mentionner les conditions dans lesquelles fut conçue , votée puis annoncée la création de la Federal Reserve et que j’analyserai plus loin. La présence de ce membre du Gouvernement prouve pour le moins la complicité de ce dernier avec les banquiers dans le “coup d’Etat constitutionnel” que banquiers et Gouvernement préparaient de conserve contre le Congrès.
Mais le personnage le plus important parmi les participants était Paul Warburg. C’était l’un des hommes les plus riches du monde . Son expérience du fonctionnement des banques européennes, sa forte personnalité et ses compétences en firent le meneur , la tête pensante du groupe et le véritable initiateur de la création de la FED. Il révèlera d’ailleurs des capacités de manoeuvrier exceptionnelles en 1913, au moment du vote de la loi au Congrès. (3)
D’origine allemande , il se fit ensuite naturaliser citoyen américain. En plus d’être un partenaire de la Coon, Loeb and Company - il avait épousé en 1893 la fille du banquier Salomon Loeb, propriétaire de la banque Kuhn, Loeb & Co de New-York - il représentait sur place la dynastie bancaire des Rothschild d’Angleterre et de France. Associé avec son frère Felix, il entretenait également des liens étroits avec son autre frère Max Warburg, le directeur en chef du consortium bancaire Warburg d’Allemagne et des Pays-Bas.
Cette fine brochette représentait donc les intérêts croisés des plus grands groupes bancaires mondiaux : les Morgan, les Rothschild, les Warburg et les Rockefeller. Les historiens du Nouveau Monde les appelleront les Barons voleurs.
Une fois arrivés dans la luxueuse propriété de J.P. Morgan sur l’ilot Jekyll, nos banquiers millionnaires s’installèrent autour d’une table et neuf jours durant, dans le plus grand secret, ils mirent au point et rédigèrent minutieusement le règlement de ce qui allait devenir le Système de la Reserve Fédérale.
3 - La préhistoire du système monétaire : de la déclaration d’indépendance en 1776 à la crise de 1907
L’action des “barons voleurs” et la décision de 1913 qui en sera le point d’orgue, n’est pas un acte isolé. C’est le dernier et le plus décisif des coups de boutoir des financiers dans la guerre féroce, tant en Europe qu’en Amérique, entre le pouvoir politique et le pouvoir des banquiers, et notamment celui des Warburg et des Rothschild d’Angleterre. Cette guerre durait depuis la Déclaration d’indépendance des colonies anglaises. Elle se termina par une victoire par KO de la finance internationale sur le pouvoir politique de l’Etat naissant et ouvrit la voie à une domination exponentielle des financiers sur le monde entier.
La bataille avait d’ailleurs commencé avant même la déclaration d’indépendance, en 1776, lorsque les banquiers de la City de Londres réussirent à faire voter par le gouvernement anglais une loi qui interdisait aux treize colonies d’Amérique de créer une monnaie locale, le Colonial Script, et de n’utiliser, pour leurs échanges, que la monnaie or et argent des banquiers. Comme cette monnaie était obtenue moyennant un intérêt, elle devenait automatiquement une dette des colonies.
Les monétaristes l’appellent une monnaie-dette et cette monnaie est un rackett permanent des banques sur l’Etat soumis à ce régime.
Au moment de la déclaration d’indépendance du nouvel Etat, méfiants, les Pères fondateurs inscrivirent dans la Constitution américaine signée à Philadelphie en 1787, dans son article 1, section 8, § 5, que “c’est au Congrès qu’appartiendra le droit de frapper l’argent et d’en régler la valeur”.
Thomas Jefferson était si persuadé du rôle pervers des banquiers internationaux qu’il a pu écrire: “Je considère que les institutions bancaires sont plus dangereuses qu’une armée. Si jamais le peuple américain autorise les banques privées à contrôler leur masse monétaire, les banques et les corporations qui se développeront autour d’elles vont dépouiller les gens de leurs biens jusqu’au jour où leurs enfants se réveilleront sans domicile sur le continent que leur Pères avaient conquis.”
Et voilà comment Jefferson a prophétisé, il y a plus de deux siècles, la crise actuelle des “subprime”, qui jette de plus en plus de citoyens américains à la rue.
Voir: La “main invisible du marché ” Une histoire de ” bulles “, de ” subprimes ” , de ” monolines ” et autres merveilles de la ” finance structurée”
Mais les banquiers ne s’avouèrent pas vaincus. Ils trouvèrent des soutiens auprès du nouveau gouvernement et notamment auprès du Secrétaire au Trésor, Alexander Hamilton et du Président George Washington lui-même. Ils obtinrent en 1791 le droit de créer une banque, abusivement appelée Banque des Etats-Unis de manière à faire croire qu’il s’agissait d’une banque de l’Etat central alors que c’était une simple banque privé appartenant à ses actionnaires.
Cette banque privée obtint, pour vingt ans, le privilège d’émettre la monnaie-dette du nouvel Etat.
Lorsqu’au bout de vingt ans, le Président Jackson voulut mettre fin à ce droit exorbitant, sortir du cycle de la monnaie-dette et revenir au droit inscrit dans l’art. 1 de la Constitution , les banquiers anglais, menés par Nathan Rothschild, suscitèrent en 1812 , sous divers prétextes commerciaux - taxe sur le thé - et maritimes - contrôle des navires - une guerre de l’Angleterre contre ses anciennes colonies et ils mirent en action toute leur puissance financière afin de ramener le nouvel Etat au rang de colonie . “Vous êtes un repaire de voleurs, de vipères, leur avait crié le Président Jackson. J’ai l’intention de vous déloger, et par le Dieu Eternel, je le ferai!”
Mais il échoua à les déloger et les banquiers eurent le dernier mot .
En 1816, les privilèges de la Banque des Etats-Unis étaient rétablis et les banquiers menés par la famille Rothschild avaient définitivement terrassé les hommes politiques qui, comme Jefferson et plus tard, Lincoln, tentèrent de s’opposer à leur racket.
C’est donc à juste titre que James Madison (1751-1836) , le quatrième Président des Etats-Unis a pu écrire: “L’histoire révèle que les banquiers utilisent toutes les formes d’abus, d’intrigues, de supercheries et tous les moyens violents possibles afin de maintenir leur contrôle sur les gouvernements par le contrôle de l’émission de la monnaie.”
Car il s’agit bien d’un racket. La guerre que mena - et perdit - Abraham Lincoln contre les banquiers en est une nouvelle illustration éclatante.
Durant la guerre de Sécession (1861-1865), la banque Rothschild de Londres finança les Fédérés du Nord, pendant que la banque Rothschild de Paris finançait les Confédérés du Sud en application d’un scénario mis au point en Europe durant les guerres napoléoniennes. Les deux groupes , profitant de la situation, exigeaient des intérêts usuraires de 25 à 36%.
Le Président Abraham Lincoln (1809-1865)
Le président Lincoln , qui avait percé à jour le jeu des Rothschild refusa de se soumettre au diktat des financiers européens et, en 1862 , il obtint le vote du Legal Tender Act par lequel le Congrès l’autorisait à revenir à l’art. 1 de la Constitution de 1787 et à faire imprimer une monnaie libérée du paiement d’un intérêt à des tiers - les dollars “Green Back” - ils étaient imprimés avec de l’encre verte. C’est ainsi qu’il a pu , sans augmenter la dette de l’Etat, payer les troupes de l’Union.
“Le pouvoir des financiers tyrannise la nation en temps de paix - écrivait-il - et conspire contre elle dans les temps d’adversité. Il est plus despotique qu’une monarchie, plus insolent qu’une dictature , plus égoïste qu’une bureaucratie. Il dénonce, comme ennemis publics , tous ceux qui s’interrogent sur ses méthodes ou mettent ses crimes en lumière . J’ai deux grands ennemis : l’armée du sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis.”
Il aurait ajouté ces paroles prémonitoires : “Je vois dans un proche avenir se préparer une crise qui me fait trembler pour la sécurité de mon pays. […] Le pouvoir de l’argent essaiera de prolonger son règne jusqu’à ce que toute la richesse soit concentrée entre quelques mains.” (Letter from Lincoln to Col. Wm. F. Elkins, Nov. 21, 1864).
Lincoln voyait clairement combien il était néfaste pour une nation souveraine que des puissances autres que l’Etat central aient le pouvoir de créer la monnaie. Il a été tué à Washington le 14 avril 1965 par John Wilkes Booth qui lui tira une balle dans la tête alors qu’il assistait à une représentation théâtrale dans la loge du Ford’s Theater.
Les causes réelles de sa mort n’ont pas été élucidées, bien que la version officielle prétende toujours que son assassin vengeait la défaite des Sudistes . De nombreuses recherches, abondamment documentées, orientent la recherche de la vérité vers un complot beaucoup plus complexe et révèlent , notamment, que Booth reçut à ce moment-là des sommes d’argent très importantes de la part d’hommes d’affaires connus et qu’il bénéficia de nombreuses et efficaces complicités, tant pour accomplir son crime que pour quitter les lieux .
Toujours est-il que le successeur de Lincoln, Andrew Johnson, semble, lui, n’avoir eu aucun doute quant à la cause de la mort de son prédécesseur : il a immédiatement et sans donner d’explication, suspendu l’impression des greenbacks et les Etats-Unis sont revenus à la monnaie-dette des banquiers.
Le 12 avril 1866, le Congrès officialisait sa décision par le vote du Contraction Act qui stipulait que les billets greenbacks de Lincoln seraient progressivement retirés de la circulation monétaire.
Il est une autre personnalité qui, elle non plus, n’avait aucun doute sur les commanditaires de l’assassinat perpétré par Booth, c’est Otto von Bismarck, Chancelier de Prusse depuis 1862, qui écrivait : “La mort de Lincoln fut un désastre pour la chrétienté. Il n’y avait pas dans tous les États-Unis d’homme qui méritât de seulement porter ses bottes. Je crains que les banquiers étrangers ne dominent entièrement l’abondante richesse de l’Amérique et ne l’utilisent systématiquement dans le but de corrompre la civilisation moderne. Il n’hésiteront pas à précipiter les Etats chrétiens dans les guerres et le chaos, afin de devenir les héritiers de la terre entière.”
4 - John Fitzgerald Kennedy et la nouvelle tentative de réforme monétaire
Il est impossible de ne pas évoquer, à la suite de celle du Président Lincoln, la tentative du Président John Fitzgerald Kennedy de dépouiller la FED de sa puissance , tellement elle lui est parallèle. Elle eut lieu un siècle exactement après celle de Lincoln. Les coïncidences biographiques, politiques et même numérologiques qui rapprochent les destins de ces deux hommes politiques sont, il faut le reconnaître, tout à fait extraordinaires et ont fait saliver de nombreux Sherlock Holmes amateurs. Leurs morts violentes semblent les avoir liés pour l’éternité dans un parcours historique en miroir.
En effet, le 4 juin 1963 , le Président Kennedy signait l’Executive Order n° 11110 (4) par lequel le gouvernement retrouvait un pouvoir inscrit dans la Constitution, celui de créer sa monnaie sans passer par la Réserve Federale. Cette nouvelle monnaie, gagée sur les réserves d’or et d’argent du Trésor, rappelait les greenbacks et le coup de force du Président Lincoln.
Le Président Kennedy fit imprimer 4,3 milliards de billets de 1, 2, 5, 10, 20 et 100 dollars. En 1994 il restait l’équivalent de 284,125,895 dollars en circulation aux Etats-Unis , détenus, probablement par des collectionneurs (source: The 1995 World Almanac).
Les conséquences de l’Executive Order n° 11110 étaient énormes. En effet, d’un trait de plume John Fitzgerald Kennedy était en passe de mettre hors jeu tout le pouvoir que les banques privées de la FED s’étaient arrogé depuis 1816 et qu’elles détenaient officiellement depuis 1913. Car si, dans un premier temps, les deux monnaies auraient circulé parallèlement, la monnaie d’Etat, gagée sur les réserves d’argent, aurait fini par terrasser la monnaie créée ex-nihilo par les banquiers. Cette nouvelle monnaie aurait considérablement diminué l’endettement de l’Etat, puisqu’elle éliminait le paiement des intérêts.
Les 26 volumes du rapport Warren n’ont pas réussi à apporter une explication crédible à l’assassinat du Président Kennedy à Dallas le 26 novembre 1963, cinq mois après sa réforme monétaire. Il n’est nul besoin d’être un ” complotiste ” primaire ou secondaire pour n’accorder qu’un crédit poli à la thèse officielle, non pas seulement à cause de l’analyse des conditions de l’exécution, mais parce que le fait que tous les témoins oculaires de l’événement soient morts dans les deux ans ; que la disparition ou l’élimination de 400 personnes en relations même lointaines avec cet événement - y compris le personnel médical de l’hôpital Parkow où Kennedy a été admis, du portier au personnel médical, ainsi que des proches du tireur accusé, Lee Harvey Oswald - que tous ces événements soient le fruit du hasard relève d’un pourcentage de probabilités si infinitésimal qu’il est proche du zéro absolu. Le calcul des probabilités devient un juge plus efficace que n’importe quelle vérité officielle.
De puissants comploteurs ont donc sévi, y compris longtemps encore après le crime initial. Parmi les innombrables pistes avancées par les uns et par les autres, la piste monétaire était évidemment tentante . Elle fut relativement peu explorée au début de l’enquête. Cependant beaucoup la tiennent pour d’autant plus avérée qu’ils rapportent une phrase du père du Président, Joseph Kennedy, lorsqu’il apprit la décision de réforme monétaire de son fils : “Si tu le fais, ils te tueront“.
Le Président John Fitzgerald Kennedy
Le message semble, une nouvelle fois avoir été reçu cinq sur cinq par le Vice-Président Lyndon B. Johnson, devenu Président par la grâce de cet assassinat. Comme son homonyme Andrew Johnson un siècle auparavant, et avec une célérité particulièrement remarquable, il suspendit la décision monétaire prise le 4 juin 1963 par le Président assassiné alors que le cadavre de ce dernier n’était pas encore froid.
“L’ordre exécutif 11110 a été abrogé par le Président Lyndon Baines Johnson , trente-sixième président des Etats-Unis - de 1963 à 1969 - alors qu’il se trouvait dans l’avion présidentiel AirForce One, entre Dallas et Washington , le jour même de l’assassinat du Président Kennedy ” écrivait un chroniqueur. Cette affirmation n’est pas exacte : le décret présidentiel n’a jamais été officiellement abrogé, mais son application fut suspendue . Fut abrogée l’autorisation d’imprimer de nouveaux billets et de frapper de nouvelles pièces, si bien que l’Executive Order n° 11110 demeure officiellement en vigueur … dans la stratosphère.
Cet assassinat était peut-être un avertissement aux futurs Présidents qui auraient voulu emboîter le pas à Abraham Lincoln et à Jahn Fitzgerald Kennedy et priver les banquiers de leur rente en éliminant le système de la monnaie-dette. Jahn Fitzgerald Kennedy aurait payé de sa vie cette provocation à la puissance de la finance internationale. Mais nous sommes là dans le domaine des innombrables coïncidences troublantes qui ont jalonné la vie de ce Président même si la célérité de la décision du Président Johnson donne du crédit à cette supposition. Eustace Mullins rappelle que le Président Abraham Garfield avait lui aussi été assassiné le 2 juillet 1881 après avoir fait une déclaration sur les problèmes de la monnaie. (5) Que de coïncidences!
Depuis le Président Kennedy, aucun successeur ne s’est avisé d’apporter la moindre réforme au fonctionnement de la FED.
De plus, des Israéliens s’étant félicité de ce que l’élimination de J.F. Kennedy ait laissé le champ libre à l’accession d’Israël au statut de puissance nucléaire, cette conséquence s’est métamorphosée en cause pour certains.
En effet, le journal israélien Ha’aretz 5 février 1999 écrivait, dans sa critique de l’ouvrage d’Avner Cohen, “Israel et la bombe: “L’assassinat du Président américain John F. Kennedy mit un terme brutal à la forte pression de l’administration des Etats-Unis sur le gouvernement d’Israël afin de l’amener à interrompre son programme nucléaire… ” L’auteur ajoute que ” si Kennedy était resté vivant, il est douteux qu’Israël aurait aujourd’hui une défense nucléaire.” Le Président Kennedy avait, en effet, fermement annoncé au Premier Ministre israélien David Ben Gourion qu’en aucun cas il n’accepterait qu’Israël devînt une puissance nucléaire.
Peut-être faudra-t-il encore vingt-six autres volumes d’enquête pour éclaircir cette énigme.
5 - Les crises monétaires successives : 1869 - 1873 - 1893 - 1901 - 1907
- La première ” Tempête sur Wall Street “, le premier ” Vendredi noir “, date du 24 septembre 1869. Elle était liée à la ruée vers l’or et aux manœuvres de deux escrocs , Jay Gould et Jim Fisk, qui soudoyèrent des fonctionnaires du Trésor afin d’accaparer tout le marché de l’or, dont les transactions s’opéraient encore en greenbacks.
- Une nouvelle panique secoue Wall Street le 20 septembre 1873. La faillite d’une société de courtage qui assurait le financement du Northern Pacific Railway provoque une vente massive des titres de la compagnie.
- Le 27 juin 1893 a eu lieu le premier krach boursier à Wall Street. Faillites, incertitudes monétaires , diminution des réserves d’or ont provoqué une panique sur les titres et une classique ruée sur les achats d’or. Le sauveur sera , déjà, J. Pierpont Morgan, que nous retrouverons à la manœuvre en 1910 et en 1913 . Après sa victoire sur Jay Gould et Jim Fisk dans la ” bataille du rail ” de 1873, Morgan se présente en sauveur du Trésor américain, après un marché conclu avec le Président Cleveland le 8 février 1895.
- Nouvelle panique à Wall Street le 9 mai 1901 à propos d’une spéculation féroce sur la même Northern Pacific appartenant toujours au même J. Pierpont Morgan qui ruina d’un même élan les investisseurs honnêtes et les spéculateurs.
- Le 13 mars 1907 voit une nouvelle chute vertigineuse des cours et comme par hasard, la même Northern Pacific se retrouve au cœur de la crise. En même temps, J. P. Morgan annonce la faillite de Knickerbocker Trust Co et de Trust Company of America qui mettent en péril tout le réseau bancaire - une petite répétition de la situation que nous connaissons aujourd’hui.
C’est dans ces grands moments-là qu’on reconnaît le prédateur de haut vol. Après avoir été le poison, notre banquier, John Pierpont Morgan, dont le nom se retrouve dans toutes les crises depuis 1869, se présente en remède et en sauveur de la nation. Un parfait pharmakon monétaire, en somme.
Ce n’est pas sans raison qu’il proclamait : “Un homme a toujours deux raisons de faire ce qu’il fait. La bonne et la vraie.” Au cours d’ une scène cocasse digne d’un scenario hollywoodien, ce personnage aussi truculent que redoutable a convoqué dans son bureau les présidents des sociétés financières, les a séquestrés toute la nuit et ne les a libérés que le lendemain matin à 5 h après les avoir contraints à verser 25 millions de dollars afin de ” sauver les banques ” qu’il avait contribué à mettre en péril .
Du coup, qualifiés précédemment de “malfrats richissimes” par le Président Theodore Roosevelt - celui qui avait envoyé la “Grande flotte blanche ” faire le tour du monde afin de démontrer la puissance des Etats-Unis - J.P. Morgan et ses acolytes se sont métamorphosés en un clin d’œil en “conservateurs solides qui agissent avec sagesse pour le bien public“. Et c’est ainsi que la “bonne raison” de faire - celle qu’il est honorable d’afficher - est devenue la “vraie raison “d’agir, c’est-à-dire la raison officielle, la raison “ad usum delphini“.
Comme John Pierpont Morgan est un des acteurs majeurs de la création de la machine de la FED, il n’est pas inutile de préciser que ce magnat des finances :
- se trouvait à la tête trois puissants groupes bancaires, J.P. Morgan & Co., First National, et National City Bank,
- qu’il contrôlait aussi quatre des cinq plus importantes compagnies ferroviaires,
- qu’il était propriétaire du méga trust de l’acier US Steel,
- qu’il avait créé la General Electric en fusionnant les sociétés Edison et Thompson,
- qu’il avait mis la main sur la flotte Leyland, ainsi que sur de nombreuses lignes qui assuraient la navigation sur le Mississipi,
- qu’il avait créé une nouvelle ligne de bateaux, la White Star et que, parmi les paquebots construits dans les chantiers navals dont il était le propriétaire, figure …le Titanic. On comprend peut-être mieux les raisons pour lesquels ce paquebot luxueux dans sa partie visible , mais fragile dans sa partie immergée en raison de l’absence de double coque, a sombré aussi rapidement .
John Pierpont Morgan , le loup-cervier cynique qui n’hésitait pas à proclamer : “Je n’ai nul besoin d’un avocat qui me dise ce que je n’ai pas le droit de faire. Je le paie pour me dire comment faire ce que je veux faire” avait pourtant lui aussi son jardin secret qu’il est juste de mentionner. Passionné d’horlogerie, il consacra une partie importante de sa fortune à enrichir une magnifique collection d’horloges et de montres anciennes, que son fils Jack légua en 1916 au Métropolitan Museum, où une aile lui est consacrée . A la deuxième génération, les louveteaux héritiers deviennent philanthropes.
6 - Les préparatifs du coup d’Etat constitutionnel
A la suite des paniques bancaires de la fin du XIXe siècle et de la plus grave d’entre elles, celle de 1907, le Congrès décida qu’il fallait réformer tout le système bancaire et, avec la National Monetary Commission (Commission Monétaire Nationale), il créa deux sous-commissions, l’une chargée d’étudier en détails le système monétaire américain tel qu’il existait et la seconde , dont il confia la responsabilité au sénateur Aldrich, était chargée d’étudier le système bancaire “européen ” , c’est-à-dire, évidemment dans son esprit, le système bancaire anglais .
Or, la banque d’Angleterre se trouvait - et se trouve toujours - entre les mains de banquiers privés et notamment de la pléthorique famille Rothschild . Il était donc aisé de deviner l’issue de ” l’étude ” du Sénateur Aldrich dont la fille avait épousé le premier héritier milliardaire, John D. Rockefeller Jr, connu pour être le porte-parole de J. Pierpont Morgan au Congrès et dont les liens avec tous les riches banquiers étaient de notoriété publique.
La réunion de l’Ile Jekyll fut donc décidée en grand secret et personne, hormis ses participants, n’en eut connaissance - ni la presse, ni le public, ni surtout le Congrès - avant l’adoption, le 23 décembre 1913 de la loi sur le fonctionnement de la Réserve fédérale, alors que la Commission monétaire avait prévu que les délibérations devaient se dérouler publiquement dans l’enceinte du Congrès.
Il fallut d’ailleurs trois grandes années aux conspirateurs pour trouver le moment propice de faire adopter leur projet par le gouvernement et pour donner une caution politico-juridique au cartel international de banques d’affaires privées qu’ils avaient imaginé durant le séjour de l’Ile Jekyll. La bataille fut rude. Il s’agissait bien d’un cartel puisque ces banquiers, rivaux les uns des autres en Allemagne, en France, en Angleterre, se mirent secrètement d’accord aux Etats-Unis afin de créer ensemble une nouvelle entité bancaire privée, elle aussi, dans laquelle ils collaboreraient étroitement et qui donnerait naissance au Système monétaire du Nouveau Monde.
La vanité du Sénateur Aldrich faillit faire capoter l’affaire : il tenait beaucoup à donner son nom à la loi qui fut présentée une première fois au Congrès en 1908 . Mais ses amitiés avec les banquiers internationaux était si bien connues que le Congrès, méfiant, retoqua le projet dans lequel il voyait la main mise d’un petit groupe de puissants banquiers sur l’économie américaine . Depuis la grande panique boursière de 1907, qui avait suivi les crises de 1873 et de 1893, que le public américain imputait aux manoeuvres des banquiers, toute initiative de leur part était frappée d’opprobre et aucun membre du Congrès n’aurait osé voter un projet qui aurait reçu le sceau de leur approbation.
C’est pourquoi une rude bataille politico-médiatique fit rage au Congrès et dans la presse durant les années 1910, 1911 et 1912 afin d’assurer la promotion de projet Jekylll . Après avoir réussi à faire élire , en 1912, le candidat qu’ils avaient choisi, le démocrate Woodrow Wilson, Gouverneur du New-Jersey et ancien président de Princeton - dont ils avaient financé la campagne et qui était leur homme - les conspirateurs eurent alors l’idée géniale de mettre dans leur jeu deux banquiers de moindre renom et démocrates, comme le Président, l’un de la Chambre des représentants, M. Carter Glass, et l’autre du Sénat, M. 0wen - donc appartenant, en principe, au parti des défenseurs des ” intérêts du peuple ” . Le nouveau Président et les deux banquiers passaient dans le pays pour des ennemis du “Wall Street MoneyTrust”.
C’est là qu’il faut admirer la rouerie et la connaissance de la psychologie des foules de nos conspirateurs. Pendant que les deux lièvres candides vantaient dans la presse le projet élaboré à Jekyll Island , devenu le Bill Owen-Glass en affirmant que ce n’était pas le projet des banquiers, les vrais rédacteurs du projet et notamment le puissant homme d’affaires et banquier , Frank Vanderlip et le sénateur Aldrich le critiquaient véhémentement dans les journaux. En même temps, ils finançaient en secret une campagne de promotion menée par des hommes de paille dans les Universités - notamment à Princeton, à Harvard et à l’Université de Chicago, subventionnée, à l’époque , par John D. Rockefeller à hauteur de cinquante millions de dollars - ainsi que dans tous les centres d’influence économique auxquels ils avaient accès.
Un des opposants les plus farouches au plan des banquiers - appelé Plan Aldrich, ou Plan pour la législation monétaire - fut Charles Lindbergh Senior, membre très actif du Congrès . Lucide, il déclarait le 15 décembre 1911:
“Notre système financier est une escroquerie et sera un fardeau énorme pour le peuple … J’affirme qu’il existe chez nous un Trust monétaire. Le plan Aldrich est une simple manipulation dans l’intérêt de ce Trust.[…] Le Plan Aldrich est le Plan de Wall Street. […] En 1907 la nature avait répondu le plus aimablement possible et avait donné à ce pays la récolte la plus abondante qu’il ait jamais eue. D’autres industries avaient parfaitement fonctionné et d’un point de vue naturel toutes les bonnes conditions étaient remplies pour que l’ année fût la plus prospère possible. Au lieu de cela, une panique a entraîné d’énormes pertes pour le pays. […] Aujourd’hui, partout des intérêts considérables sont mobilisés afin de pousser l’adoption du Plan Aldrich. Il se dit qu’une somme d’argent importante a été levée à cette fin. La spéculation de Wall Street apporta la Panique de 1907. Les fonds des déposants furent prêtés aux joueurs et à tous ceux que le Trust Monétaire voulait favoriser. Puis quand les déposants voulurent récupérer leur argent, les banques ne l’avaient plus. Cela a créé la panique.” (Charles A. Lindbergh, Sr., Banking, Currency and the Money Trust, 1913, p. 131)
Rien n’y fit, le projet des banquiers s’est finalement imposé, ainsi que l’avaient programmé les habiles conspirateurs. Il fut présenté comme une mesure libérale et hostile à la finance internationale.
L’opération de vote au Congrès se déroula cependant d’une manière extra ordinaire dans ce genre d’enceinte. En effet, le Federal Reserve Act fut présenté en catimini et dans une discrétion absolue, le 23 décembre 1913, dans la nuit, entre 1h30 et 4h30, au moment où les membres du Congrès étaient soit endormis, soit en vacances pour les fêtes de Noël. Les députés démocrates présents, soutenus par le Président Wilson, affirmaient d’ailleurs, la main sur le coeur, qu’ils votaient contre le projet des banquiers et “en faveur de la réduction des privilèges” des banquiers.
Dans la foulée, le projet passait le jour même et immédiatement au Sénat, si bien que le 23 Décembre 1913, à 6h02, toute l’affaire était bouclée et le projet était définitivement adopté.
Le député républicain, Henry Cabot Lodge père, lucide, critiquait vertement ce vote. Il prévoyait qu’il engendrerait un “flux de papier-monnaie non échangeable” qui “noierait la monnaie d’or” et provoquerait une “inflation énorme de moyens de paiement“. Sa prophétie s’est réalisée au-delà de ce qu’il avait imaginé.
Mais le commentaire toujours aussi lucide et prophétique a été fait devant le Congrès, immédiatement après le vote, par Charles A. Lindbergh, le père du célèbre aviateur:
“Cette loi établit le trust le plus gigantesque sur la Terre. Quand le Président signera ce projet de loi, un gouvernement invisible , le pouvoir invisible de la puissance financière sera légalisé. Les gens peuvent ne pas s’en apercevoir immédiatement, mais le jour des comptes n’est éloigné que de quelques années. Les trusts se rendront bientôt compte qu’ils sont allés trop loin, même pour leur propre bien. Les gens devront faire une déclaration d’indépendance afin de se délivrer du Pouvoir Monétaire. […] . Le plus grand crime législatif de tous les temps a été commis par le Congrès pour avoir permis le vote de ce projet de loi bancaire. […] La nouvelle loi provoquera de l’inflation tant que le cartel le souhaitera…”
En revanche, le New-York Times ne cachait pas son enthousiasme et dans son édition du 23 décembre 1913, il se félicitait de la “vitesse sans précédent” qui avait marqué l’adoption de la loi et ajoutait qu’ “on voit la main excellente de Paul Warburg dans cette stratégie finale“.
L’éditorial de ce même journal contient un commentaire dithyrambique du projet : “Le projet de loi portant sur les Opérations de banque et de Monnaie s’améliorait et devenait plus sain chaque fois qu’il passait d’une extrémité du Capitole à l’autre. Le Congrès a travaillé sous la surveillance publique dans la fabrication de ce projet de loi.”
Eustace Mullins, dans son excellent Secrets de la Réserve Fédérale, dont je parlerai plus loin, ajoute ce commentaire ironique : “Par surveillance publique, le Times apparemment voulait désigner Paul Warburg, qui pendant plusieurs jours avait gardé un petit bureau dans le bâtiment du Capitole, où il dirigeait la campagne couronnée de succès d’avant-Noël de passer le projet de loi et où les Sénateurs et des Membres du Congrès venaient toutes les heures à sa demande pour conduire sa stratégie. […] ”
Dans son ouvrage, The New Freedom (La Nouvelle Liberté), le Président Wilson semble avoir enfin compris, mais trop tard, combien il avait été manipulé : “Une grande nation industrielle se trouve dominée par son système de crédit. (…) La richesse de la nation et toutes nos activités sont entre les mains de quelques hommes . (…) Nous en sommes venus à être une des nations les plus mal dirigées, un des gouvernements les plus totalement contrôlés et dominés du monde civilisé - non plus un gouvernement régi par des opinions librement exprimées, un gouvernement de la loi et du vote à la majorité, mais un gouvernement placé sous la contrainte et la férule d’un petit groupe d’hommes.” (Woodrow Wilson, The New Freedom : A Call for the Emancipation of the Generous Energies of a People)
Ce n’est que six ans après fameuse réunion de l’Ile Jekyll, en 1916 , que Bertie Charles Forbes en révéla l’existence dans la revue qu’il venait de fonder, le Forbes Magazine. Le Federal Reserve Act était voté et les dés étaient jetés depuis trois ans . (6)
Depuis lors, l’île Jekyll a été vendue à l’ Etat de Georgie et une maison porte une plaque sur laquelle est inscrite la phrase : “Le système de la Réserve fédérale fut créé dans cette maison”.
7 - Histoire de l’Histoire de la révélation au public du Système de la Réserve fédérale
Les péripéties détaillées des préparatifs du singulier voyage des conspirateurs et du séjour qui s’ensuivit se trouvent consignées depuis lors dans divers ouvrages, dont le plus connu aujourd’hui est celui d’Edward Griffin. Cet ouvrage de vulgarisation a paru en anglais en 1995 - soit 85 ans après la réunion de l’île Jekyll - et il fut traduit en français sous le titre La créature de Jekyll Island. Il reprend, en le romançant , mais sans jamais le citer, certaines informations déjà contenues dans le premier ouvrage de fond sur la question d’ Eustace Mullins, Secrets of the Federal Reserve, The London Connection, qui lui est antérieur de près d’un demi siècle, puisqu’une première version , Mullins , The Federal Reserve ,a vu discrètement le jour en 1948.
Deux autres ouvrages beaucoup plus tardifs ont été rédigés sur ce sujet : The Case Against the Fed by Murray Newton Rothbard, 1994 et Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the country by William Greider, 1989.
Le manuscrit définitif de Mullins a ensuite été refusé par dix-huit éditeurs. Après deux ans de vaines recherches, le dix-neuvième éditeur écrivit à l’auteur: “J’aime votre livre, mais nous ne pouvons pas le publier. Personne d’autre ne le peut à New-York . Présentez-nous le synopsis d’une nouvelle et je pense que nous pourrons vous faire un à-valoir. Mais vous pouvez oublier l’espoir de voir publié l’ouvrage sur la Réserve Fédérale. Je doute qu’il soit jamais édité.”
Une version complétée a cependant paru en 1952 , à compte d’auteur après deux ans de tribulations, grâce au soutien de deux disciples du poète Ezra Pound, Kasper et Norton. Les frais de l’édition avaient été partagés entre l’auteur et les deux éditeurs , lesquels reprirent modestement le premier titre de l’ouvrage Mullins, The Federal Reserve. Ce titre, en retrait par rapport à celui refusé par les éditeurs, suggérait qu’il s’agissait simplement de l’opinion de M. Mullins sur la Réserve Fédérale .
Mais en 1954 , une édition pirate, avec des coupures, voyait le jour dans le New-Jersey sous le titre : La Conspiration de la Réserve Fédérale.
En 1955 , l’éditeur Guido Roeder acceptait la parution d’une édition en langue allemande. Cependant, la pression politique des Etats-Unis sur l’Allemagne était telle à l’époque que la totalité des 10 000 exemplaires de la première édition fut saisie et condamnée à la destruction par le feu.
Le dernier autodafé d’un ouvrage en Occident, et le seul depuis la fin de la guerre, se déroula le 21 avril 1961 sous la direction du juge Israël Katz de la Cour suprême de Bavière et avec l’approbation du Haut Commissaire des Etats-Unis en Allemagne James B. Conant, qui avait pourtant exercé de 1933 à 1953 la fonction de Président de la prestigieuse Université d’Harvard. Konrad Adenaeur était alors Chancelier d’Allemagne.
Le précédent autodafé européen remontait à 1933. C’est le grand autodafé du 10 mai 1933, à Berlin au cours duquel les nazis avaient décrété que ” le livre juif et communiste, doit être détruit “. Il avait été accompagné du rituel inspiré de l’Inquisition du Moyen-Age , avec parades, chants, torches et hérauts. La grandiose mise en scène ravissait toujours une population inculte et idéologiquement manipulée .
En 1980, toujours en Allemagne, une édition identique à celle qui avait subi l’infamie de la crémation sacrilège put enfin voir le jour sous son titre complet : Secrets of the Federal Reserve, The London Connection. Le Chancelier Helmut Kohl se trouvait à la tête du gouvernement de Bohn et le pouvoir d’influence et même d’intervention directe des Etats-Unis dans les affaires allemandes, avait sensiblement décliné depuis Adenauer .
Aucune édition française de cet important ouvrage n’a été programmée à ce jour.
L’ostracisme qui frappe l’excellent ouvrage de Mullins, pillé par ses successeurs, mais jamais cité, trouve sa cause dans le soutien de l’auteur au poète Ezra Pound et au qualificatif “ignominieux” d’antisémitisme qui les frappe tous les deux. L’étude minutieuse, scientifique et honnête de Mullins porte sur les circonstances qui ont accompagné la naissance de la Réserve Fédérale et l’action des banquiers, et nullement sur un quelconque complot national ou mondial de telle ou telle catégorie de citoyens. Il est dommage qu’elle fasse l’objet d’un procès d’intention, alors que personne ne songe à rejeter les oeuvres de James Joyce, de Yeats ou d’Hemingway qui sont, eux aussi, restés fidèles toute leur vie à leur ami Ezra Pound ; personne n’ose accoler à ces prix Nobel de littérature l’étiquette infamante d’ “antisémite” qui est la manière contemporaine de clouer un auteur au pilori et de censurer son oeuvre.
8 - Ezra Pound et son combat contre l’usurocratie
L’ouvrage de Mullins est dédicacé aux deux personnes dont la collaboration s’est révélée pour lui la plus précieuse . Outre le contenu ultra sensible de l’ouvrage dans le pays du libéralisme triomphant , de l’argent-roi et des hécatonchires de la finance nationale et internationale, ils permettent de mieux comprendre les raisons des tribulations éditoriales d’une étude pourtant si importante et si finement documentée.
Le premier dédicataire, George Stimpson, l’ami fidèle et le plus proche collaborateur de l’auteur était un intellectuel éminent, mais inoffensif ; mais c’est surtout le second dédicataire, l’écrivain et poète Ezra Pound, dont la réputation politique était sulfureuse après 1945, qui suscitait le recul horrifié des éditeurs. Mullins le fréquenta assidûment durant l’internement de Pound comme prisonnier de guerre américain - donc prisonnier de son propre pays - dans un asile psychiatrique .
Ezra Pound fut, en effet, à l’origine de l’idée même de l’ouvrage sur la Réserve fédérale, ainsi que l’auteur le reconnaît dans sa préface. Il lui rend d’ailleurs un vibrant et chaleureux hommage. C’est lui qui incita Mullins à entreprendre ses recherches dans la bibliothèque du Congrès - démarche et recherches qu’il était interdit à l’interné d’effectuer . On apprend que Pound subventionna même Mullins sur les modestes ressources qu’il semble avoir conservées, afin de l’aider dans son entreprise - dix dollars par semaine -
FED, SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS
- Au cœur de la crise -
LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE :
Le hasard fait bien les choses
SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS :
Après le plongeon de 1929 La dérive commence
Les banques créent de la monnaie Liquidité et solvabilité Bilan Effet de levier
Glissade vers l'anarchie financière
Instruments spéculatifs Inefficacité des contrôles Opacité des marchés
Plan organisé ? Que faire ?
LA CRISE DE 2007-2012 :
Réformer les retraites Endettement
La dette publique, source d'enrichissement des banques privées
Dollar Le système monétaire international est-il en crise ?
Taux d'intérêts Interventions de la Fed Inflation Croissance ou récession
La bourse L'or et ses équivalents modernes Le pétrole
Hedge funds Private equity funds
Cross-border leasing Emprunts structurés Stupid German money
Oubliez tous les critères Crise passagère ou systémique ? L'affaire Eliot Spitzer
Chronologie de la crise : 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (page II)
LA RÉSERVE FÉDÉRALE AMÉRICAINE
La Réserve fédérale des Etats-Unis (ou Fed) est au centre du système financier américain, pour ne pas dire au centre du système financier mondial. A la fois banque d'émission du fameux "billet vert", instance de contrôle du système bancaire US, organisme décideur en matière de politique monétaire (taux d'intérêts) et banque des banques, elle est en apparence placée sous le contrôle du gouvernement américain. C'est en effet la Maison Blanche qui nomme, avec l'accord du Sénat, les cinq gouverneurs qui la dirigent (Board of Governors).
En réalité, et contrairement aux banques centrales de la plupart des autres pays, la Fed est depuis sa fondation, en décembre 1913, une banque strictement privée. Organisée de manière fédérale (siège à Washington, DC), elle comporte douze banques régionales situées à New York, San Francisco, Chicago, Atlanta, Boston, Dallas, Cleveland, Philadelphie, Kansas City, Saint-Louis, Minneapolis et Richmond (Virginie). Chaque Reserve Bank régionale a pour actionnaires les principales banques privées de la région. Toutefois, la liste complète des actionnaires, et surtout la part de capital que détient chacun d'eux, n'est pas publiée.
Compte tenu de l'influence prépondérante qu'exerce la Fed tant aux Etats-Unis qu'à l'échelle internationale, il serait extrêmement intéressant de connaître cette liste. Malheureusement, il s'agit là d'un secret bien gardé. Des listes circulent sur Internet ; le moins qu'on puisse dire, cependant, c'est qu'elles ne brillent pas par leur actualité. On y trouve des noms d'établissements bancaires depuis longtemps disparus ou fusionnés avec d'autres, tandis que les banques les plus importantes en ce début de 21ème siècle (Citigroup, Bank of America) n'y figurent pas du tout.
Edouard Mandell House et la Fed : Aux sources du chaos mondial actuel par Aline de Diéguez.
E.M. House (alias Colonel House) fut à la fois l'éminence grise du président démocrate Woodrow Wilson (à la Maison Blanche de janvier 1913 à janvier 1921) et le porte-parole discret mais efficace des banquiers de Wall Street et du lobby sioniste juif naissant.
Le hasard fait bien les choses
Bien entendu, les questions essentielles que chacun se pose (Qui est derrière ces banques ? A qui appartient Wall Street ? Qui possède et dirige le monde de la finance et de l'économie ?) ne seraient pas résolues au seul vu de la liste complète des actionnaires de la Réserve Fédérale. Ce serait cependant un pas dans la bonne direction.
Toujours est-il que les cinq gouverneurs de la Fed, les cinq hommes qui dirigent sans appel et sans concurrence cette institution - avec toutes les implications que cela comporte - sont tous, sans exception, des Juifs sionistes (un Juif non-sioniste n'accédera jamais à un tel poste de responsabilité). Dire cela à haute voix équivaut bien sûr à violer un tabou absolu - voir ici.
On objectera peut-être que l'origine ethnique des gouverneurs est sans importance et qu'elle est tout simplement due au hasard. Cinq Juifs - et alors ?... On aurait pu, aussi bien, prendre cinq Noirs, ou cinq Arabes, ou cinq Chinois, ou cinq Italiens, ou cinq Mexicains, ou cinq Irlandais, ou cinq Polonais, ou pourquoi pas (dans les années 1930) cinq Allemands tout ce qu'il y a de plus nazis. Oui, on aurait pu, mais on ne l'a pas fait - et on ne le fera jamais. On aurait pu, à la rigueur, se donner la peine de diversifier la composition du Board. Mais quand on détient le monopole du pouvoir médiatique, la chose est parfaitement inutile. Si quelqu'un râle, il suffit d'invoquer l'Holocauste. D'ailleurs personne ne râle - on sait ce qu'il en coûte.
Evidemment, la Bande des Cinq roule pour Israël et pour son "inexistant" lobby. Elle jouit de la confiance et du soutien des banquiers les plus influents du district financier (eux aussi, pour la plupart, juifs et sionistes). Elle est là pour réaliser leur politique et pour veiller à ce qu'ils s'enrichissent encore plus. Lorsque les zabominables zantisémites reprochent aux milliardaires juifs de "contrôler" la Fed, ils sont encore en deçà de la vérité : la haute finance juive et la Fed, c'est en réalité la même chose - à 100 %.
En 2008, la Réserve fédérale fait beaucoup parler d'elle - comme d'ailleurs bien d'autres banques de par le monde, et comme l'ensemble des marchés financiers.
SYSTÈME BANCAIRE ET MARCHÉS FINANCIERS
On a cru très longtemps que le monde avait tiré les leçons de la grande crise des années 1930 et qu'une telle catastrophe ne se reproduirait plus jamais. On n'en est plus très sûr aujourd'hui. Pourquoi ?...
Après le plongeon : reprise en mains et capitalisme apprivoisé
Au lendemain de la grande secousse boursière de 1929-1930, qui ébranle l'économie mondiale et voit la faillite d'un grand nombre d'entreprises et de banques, le gouvernement Franklin Roosevelt met en œuvre le New Deal, un gigantesque plan de relance par l'investissement public et la consommation, inspiré par l'économiste britannique John Maynard Keynes. On veut à tout prix amortir les bouleversements sociaux avant qu'ils ne conduisent à une situation révolutionnaire. En effet, le socialisme soviétique, qui épargne à l'URSS les effets de la crise mondiale (ne parlons pas des autres problèmes), n'est pas sans exercer un certain attrait sur les "damnés de la terre" du monde occidental.
Le président américain, imité en cela par les pays européens, prend un ensemble de mesures destinées à assainir le secteur financier, afin d'empêcher qu'une catastrophe similaire ne se répète à l'avenir. Dès le milieu des années 1930, et surtout après 1945, on établit partout des mécanismes de contrôle et une séparation assez stricte entre banques commerciales (ou banques de dépôts) et banques d'affaires (ou banques d'investissement)*.
* La loi Glass-Steagall, promulgée sous Roosevelt, instaure ce principe et crée le système fédéral d'assurance des dépôts bancaires (FDIC). Elle sera peu à peu vidée de son contenu à partir de 1980 puis définitivement abrogée en 1999, ouvrant ainsi la porte à tous les excès. Cependant, le FDIC continue d'exister.
Les banques commerciales se contentent d'offrir à leurs clients (particuliers et entreprises) les services essentiels dont ils ont besoin (paiements, transferts, placements et opérations de bourse "simples", crédits "classiques", financement de la production, du commerce, de l'import-export). Elles ne sont pas autorisées à spéculer pour leur propre compte, mais peuvent se lancer dans des opérations à risque dans la mesure où un de leurs clients en assume la totale responsabilité financière.
Les banques d'affaires, elles, occupent le haut de gamme de la palette bancaire (clientèle privée triée sur le volet, gestion de patrimoine, grandes fortunes, gros portefeuilles boursiers, très grandes entreprises) et se consacrent à tout ce qui reste inaccessible aux banques commerciales : prises de participation, acquisitions d'entreprises, fusions, introductions en bourse, financement d'investissements importants.
Grosso modo on peut dire que la banque commerciale a les deux pieds solidement rivés au sol, tandis que la banque d'affaires se distingue de préférence dans les exercices de haute voltige (mais il y a encore un filet).
Dans la plupart des pays existent aussi des secteurs bancaires particuliers, en marge des circuits "standard" : caisses d'épargne publiques, banques coopératives ou mutualistes, banques hypothécaires, instituts spécialisés. Le morcellement du marché financier et le haut degré d'autarcie de chaque secteur minimise le risque d'une nouvelle crise généralisée. Le contrôle de l'Etat a du bon. Aux Etats-Unis, les banques ne sont autorisées à opérer que dans les limites de l'état où se trouve leur siège (les banques de Miami seulement en Floride, celles de San Francisco seulement en Californie, celles de Wall Street seulement dans l'état de New York).
A tout cela vient s'ajouter dans beaucoup de pays, et non des moindres, un contrôle des changes plus ou moins rigide. Chaque Etat a sa propre monnaie et s'efforce de la défendre contre la spéculation. Beaucoup de monnaies ne sont pas convertibles ou ne le sont que partiellement, En France, vers 1968-1969, un particulier doit encore solliciter une autorisation spéciale de la Banque de France s'il veut dépenser plus de 1.000 francs* hors de l'Hexagone - pas 1.000 francs par jour, ni par semaine, ni par voyage, mais 1.000 francs par an. Les entreprises, elles, ne peuvent transférer de l'argent à l'étranger que si elles justifient de l'importation effective de marchandises dans le cadre légal autorisé, et les exportateurs doivent obligatoirement rapatrier leurs fonds. Côté services, où par la force des choses un contrôle matériel aux frontières n'est pas possible, la procédure est encore plus lourde et compliquée. Quant aux investissements français à l'étranger (mais aussi étrangers en France), les barrières bureaucratiques sont très élevées. On est loin, très loin, de la libre circulation des capitaux que nous connaissons aujourd'hui.
* en pouvoir d'achat, environ 1.200 euros de 2008
Et même à l'intérieur d'un même pays, les autorités financières n'hésitent pas, quand elles le jugent utile, à imposer "l'encadrement du crédit", c'est-à-dire l'obligation pour les banques de limiter le montant global des crédits qu'elles consentent à leur clientèle. De la sorte, on réduit la masse monétaire, donc l'inflation (le fléau permanent de cette époque).
La dérive commence
Dans les années 1960, avec la hausse du pouvoir d'achat de la population dans la plupart des pays occidentaux, l'accès à la banque se démocratise. Tout le monde a désormais un ou plusieurs comptes, tout le monde (ou presque) commence à mettre de l'argent de côté, pense à s'acheter une maison et aimerait bien tenter sa chance au casino de la bourse. La clientèle populaire devient intéressante et promet de juteux profits, à condition que les strictes réglementations bancaires soient levées. Le grand capital a hâte de sortir du ghetto de la banque d'affaires pour avaler tous les autres domaines réservés. Il veut également briser toutes les entraves qui frappent encore ses propres opérations.
A partir de 1980, sous l'impulsion de l'administration Reagan, on assiste un peu partout dans le monde au décloisonnement, à la dérégulation et à la privatisation des réseaux bancaires, là où ils n'étaient pas encore privatisés. En France, on nationalise d'abord le secteur privé en 1981*, avant de reprivatiser toutes les banques en 1986**, y compris les trois plus grandes, qui étaient aux mains de l'Etat depuis 1945.
* sous Mitterrand, avec un gouvernement d'union de la gauche
** également sous Mitterrand, mais avec un gouvernement de droite (cohabitation)
Parallèlement, les marchés s'ouvrent progressivement, l'argent se met à circuler librement par-delà les frontières, les frontières elles-mêmes commencent à s'estomper. On entre un peu dans la mondialisation, même si ce mot n'est pas encore en usage. En matière bancaire et monétaire, les pays de l'Union européenne adoptent d'abord les critères allemands de gestion et de comptabilité, puis tout le monde s'aligne sur les critères américains, dits "internationaux", suivant la devise : Vous nous ouvrez votre porte, très bien. Mais ayez au moins la courtoisie d'adopter notre style et nos méthodes... Et notre langue, bien sûr. Le jargon comptable et financier européen regorge d'expressions américaines sans équivalent dans les autres langues.
Les banques créent de la monnaie... et du risque
Dans un bilan, le passif est le côté où sont enregistrées les dettes d'une entreprise, qui sont aussi des ressources, puisqu'elles lui permettent de financer son activité. L'actif, lui, renseigne sur ce que possède l'entreprise, c'est-à-dire sur la manière dont elle emploie ses ressources.
Au passif d'un bilan bancaire on trouve, entre autres, les sommes que la banque doit à ses clients (dépôts), à d'autres banques, à des prêteurs (souscripteurs d'obligations par exemple), à des créanciers (comme les acheteurs de "produits" financiers émis par la banque) et à ses actionnaires (capital, réserves). L'actif enregistre les crédits consentis à la clientèle, les créances sur des tiers, les avoirs en caisse ou en compte auprès d'autres banques, les titres financiers que la banque a acquis pour son propre compte et les biens immobiliers dont elle est propriétaire.
Contrairement à ce que pense fréquemment "l'homme de la rue", les banques ne se contentent pas de recueillir l'argent de leurs clients pour le prêter à d'autres dans la limite des dépôts reçus. La réalité est sensiblement plus complexe.
En effet, tout nouveau crédit crée automatiquement un avoir en faveur de celui qui en bénéficie. Il en résulte donc un nouveau dépôt au passif de la banque (ou éventuellement au passif d'un autre établissement bancaire, si le bénéficiaire du crédit vire l'argent à un tiers). Il est donc impossible, quand on consulte un bilan bancaire, de savoir si les sommes déclarées comme avoirs de la clientèle représentent de véritables dépôts ou si, au contraire, elles proviennent d'une opération de crédit.
Le crédit étant la raison d'être de toute banque, l'augmentation des dépôts entraîne l'octroi de nouveaux crédits, qui à leur tour vont gonfler les dépôts, qui eux-mêmes etc... L'effet "boule de neige" qui en résulte - du moins en théorie - peut avoir des conséquences catastrophiques si on n'y prend garde.
Les banques participent donc à la création de monnaie. Elles y participent même dans une plus large mesure que la banque d'émission. A l'heure actuelle, la monnaie fiduciaire créée par celle-ci (les espèces) représente environ 7 % de la masse monétaire*. Le reste (93 %) prend en gros la forme d'avoirs en compte (monnaie scripturale), dont une bonne partie résulte d'un tour de passe-passe nommé crédit.
* Fin 2007, il y avait dans la zone euro pour 600 milliards de billets et pièces en circulation, pour une masse monétaire totale (M3) de 8.600 milliards. En février 2009, conséquence directe des "injections" opérées dans le cadre de la crise, ces chiffres sont passés à 740 et 9.427 milliards respectivement, et en novembre 2011 à 866 et 9.850 milliards.
On distingue divers agrégats monétaires : M1 (moyens de paiement au sens strict, c'est-à-dire monnaie fiduciaire + dépôts bancaires à vue) ; M2 (= M1 + la quasi-monnaie, c'est-à-dire les comptes d'épargne et les dépôts à terme à moins de deux ans) ; M3 (= M2 + les titres de placement et instruments négociables sur le marché monétaire émis par les banques et établissements financiers, comme par exemple les certificats de dépôt et les parts de SICAV ou de fonds communs).
Outre la monnaie fiduciaire mise en circulation par la banque centrale, il existe une monnaie scripturale "centrale" matérialisée par les avoirs des banques auprès de l'institut d'émission. Ce poste ne représente qu'une petite fraction du total.
Pour pallier au problème résultant de la création de monnaie par le biais du crédit, on exige des banques qu'elles placent auprès de leur banque centrale, sous forme de réserves obligatoires, un certain pourcentage des dépôts à vue ou à court terme qu'elles reçoivent de la clientèle. Cette mesure, qui gèle en quelque sorte une partie des fonds reçus en même temps que leur équivalent à l'actif, constitue aussi un outil de régulation dans le cadre de la politique monétaire - tout comme le maniement des taux par la banque centrale ou son intervention directe sur le marché monétaire (le marché de l'argent à court terme) pour fournir aux banques les liquidités dont elles ont besoin ou, au contraire, pour éponger les excédents de liquidités.
Autre contrainte, servant indirectement de frein à la distribution du crédit - même si elle a avant tout pour fonction de sécuriser le système bancaire : les autorités de contrôle imposent aux banques le respect de ratios comptables censés refléter le degré de liquidité (l'aptitude à satisfaire à un moment donné les demandes de retrait de la clientèle) et le degré de solvabilité (l'aptitude à satisfaire le remboursement de toutes les dettes du passif, quelle que soit leur échéance, au cas où une liquidation totale de la banque deviendrait nécessaire). Une cessation de paiement par manque de liquidités ne débouche pas fatalement sur l'insolvabilité - à condition toutefois que quelqu'un soit disposé à fournir ces liquidités : un repreneur qui y trouvera son compte ou... l'Etat-vache à lait.
Liquidité et solvabilité
Pour évaluer la liquidité, on compare, pour chaque échéance donnée, les postes correspondants de l'actif et du passif, en les décomptant soit à 100 % soit à un taux inférieur pour certains éléments du passif pour lesquels la réglementation considère que la probabilité d'une demande de retrait est moindre. Le fait de ne décompter certains de ces postes que pour 40, 20, 10, voire 5 % de leur valeur est passablement arbitraire. En cas de défaillance, on sera en droit de parler de maquillage légal.
Pour la solvabilité, on compare les fonds propres de la banque (capital, réserves) aux risques de l'actif pondérés de tel ou tel coefficient suivant la catégorie de risque et la "qualité" de l'emprunteur - ce coefficient étant lui aussi plus ou moins arbitraire. Le problème, en la matière, vient surtout du fait que de nouveaux éléments font régulièrement leur apparition, sans qu'on sache exactement dans quelle catégorie les classer et quel coefficient leur appliquer. En fait, beaucoup d'instruments ou "véhicules" financiers nouvellement mis en place sont nés de la volonté de tourner la réglementation existante. Lorsqu'une banque en détient dans ses actifs, il n'est pas rare que la part de fonds propres qu'elle est légalement tenue de posséder en contrepartie, soit tout à fait insuffisante.
Les engagements sur instruments financiers à terme, qui figurent hors-bilan, n'entrent en ligne de compte dans le ratio de solvabilité que pour une fraction infime de leur volume, sous prétexte que le risque qui en découle est infime, lui aussi.
On a vu dans le cas de la Société Générale qu'il n'en est rien, les pertes effectives représentant alors 10 % de l'encours (voir plus bas). En appliquant les méthodes de calcul préconisées à l'échelle internationale par le Comité de Bâle*, on aboutit à un "équivalent risque" de moins de 1 %.
Lorsqu'une liquidation bancaire devient nécessaire, la valeur réelle des actifs s'avère toujours inférieure à leur valeur comptable figurant au bilan. La question qui se pose alors est de savoir si cette valeur réelle est suffisante pour permettre le remboursement intégral des dépôts et des autres dettes du passif découlant de l'émission de titres et "produits" financiers (obligations, ABS, etc. - voir plus bas), ces titres se retrouvant bien sûr en grande quantité dans les portefeuilles d'autres banques.
Les fonds propres servent à amortir une diminution éventuelle de l'actif et devraient donc, de ce fait, toujours être supérieurs au potentiel de dépréciation de celui-ci. Quand ce n'est plus le cas, une recapitalisation doit en principe intervenir. Pour atteindre un haut niveau de sécurité, il n'y a en fait que deux alternatives : 1) éviter systématiquement les crédits à risque et les "produits" financiers douteux, ou 2) augmenter ses fonds propres de telle manière qu'on sera toujours en mesure de faire face à une dépréciation des actifs, aussi grave soit-elle. Bien entendu, aucun de ces deux critères "durs" n'est imposé aux banques.
Plus grave encore, il arrive fréquemment que les établissements financiers émetteurs de titres et autres "instruments innovatifs", ne les fassent pas du tout figurer à leur bilan - parfois en toute légalité, par exemple parce qu'ils les ont externalisés (voir plus bas).
* Selon l'accord Bâle II de 2004, les fonds propres d'une banque doivent représenter au minimum 8 % de ses risques, le "paquet risques" à prendre en considération étant composé de la manière suivante : 75 % de risques de crédit + 5 % de risques de marché + 20 % de risques opérationnels. En principe, Bâle II constitue un progrès par rapport à l'accord précédent (Bâle I de 1988) qui ne retenait que les risques de crédit. Mais comme la structure des bilans bancaires a très fortement évolué entre 1988 et 2004 (voir plus bas l'exemple de la Société Générale), 5 % pour les risques de marché est un taux tout à fait insuffisant. La crise actuelle montre que le vrai danger n'émane pas tant des crédits qu'une banque consent directement à ses clients, mais plutôt des créances plus ou moins douteuses qu'elle acquiert sur le marché. Si les risques résultant de ces "placements avantageux" étaient évalués correctement, la contrepartie en fonds propres serait telle que le marché se tarirait très rapidement. En 2008, beaucoup de banques se vantent de respecter un ratio de capital supérieur aux 8 % exigés. Dans la plupart des cas, cela ne veut strictement rien dire. Ce n'est pas de 9 % que la banque Lehman aurait eu besoin pour éviter la faillite, mais de 50 ou plus.
En septembre 2010, on présente l'accord Bâle III qui renforce la capitalisation des banques... mais sans mettre fin à la possibilité légale d'exclure certains risques du bilan. Avec cette réformette, le taux de 8 % reste inchangé. Ce qui varie, c'est la composition des 8 %. Bâle II prévoyait au niveau 1 (Tier 1) au moins 4 % de fonds propres permanents, dont 2 % de fonds propres "durs" (Core Tier 1), le reste pouvant être composé de fonds propres temporaires (réserves, provisions) au niveau 2 (Tier 2). Bâle III fait passer le Tier 1 à 6 %, dont 4,5 % pour le Core Tier 1, progressivement jusqu'en 2015. A cela viendra s'ajouter, d'ici 2019, un "matelas de protection" de 2,5 %, c'est-à-dire qu'on aura alors un minimum de 7 % de Core Tier 1... plus le reste. C'est de la poudre aux yeux, car toutes les banques devenues insolvables ces dernières années avaient déjà des ratios de "solvabilité" supérieurs à ce qui sera exigé dans neuf ans. Quant aux modalités de détail, elles sont au moins aussi tordues que celles de 2004 et permettront sans aucun doute toutes les tricheries. Rien de nouveau, donc, de ce côté-là - ce sont bien entendu des banquiers qui ont concocté la "réforme".
Dans le cadre de Bâle III, un ratio de levier (destiné à contrôler l'effet de levier des opérations spéculatives) est prévu... pour 2015 ; un ratio de liquidité à long terme sera appliqué... à partir de 2018. Comme on peut le lire dans cet article : La réforme bancaire de Bâle 3 pour les nuls, "le calendrier a été tellement assoupli pour tous les ratios, que cela laisse aux banques le temps de voir... une autre crise".
En laissant de côté le facteur temps, on peut dire que le ratio de solvabilité de Bâle est, comme tout ratio, le rapport de deux grandeurs (ici : fonds propres / risques). Comme il faut augmenter la valeur apparente de ce ratio (ce qui est positif au niveau de la communication), on s'efforce de gonfler un peu l'expression comptable du premier terme (les fonds propres) et de minimiser beaucoup celle du second (les risques), indépendamment bien sûr de la valeur réelle de l'un et de l'autre. Le but recherché n'est pas la sécurité mais l'impression de sécurité. Pas étonnant que certains commentateurs parlent, à propos du nouvel accord de Bâle, de "réforme à deux balles", voire même de "trou de Bâle".
BILAN SOMMAIRE DE LA BANQUE X :
La part relative de A3 est en général très limitée (souvent moins de 5 % du total). En cas de liquidation, le patrimoine immobilier de la banque en faillite peut néanmoins constituer un des éléments les plus intéressants pour le repreneur (voir Bear Stearns, Lehman Brothers).
La part relative de A1 par rapport à A2 n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, au fur et à mesure que les "investissements" purement financiers supplantaient les crédits à l'économie réelle. Il n'est pas rare, en 2008, de voir des banques dites "commerciales" détenir 70 ou 80 % d'actifs financiers.
A2 et surtout A1 ont tendance à se déprécier très vite. Aux Etats-Unis, les risques de crédit contenus dans A2 sont plus élevés que dans n'importe quel autre pays, étant donné que les crédits directs accordés par les banques US l'ont été de manière inflationnaire, sans contrôle réel et sans aucun respect des règles prudentielles. Mais bien souvent, ces crédits n'apparaissent pas du tout au bilan (externalisation).
Les risques financiers contenus dans A1 ont le plus souvent leur origine aux Etats-Unis et se retrouvent - titrisation aidant - dans tous les bilans de banque de la planète. Ils en constituent le poste le plus toxique, le plus explosif. A la base, il s'agit soit de crédits douteux accordés par quelques grandes banques, soit de dérivés ou autres "produits innovatifs" concoctés par elles.
La part relative de P1 par rapport à P2 a également tendance à augmenter, surtout lorsque la banque réussit à faire accepter ses "produits" sur le marché et que cette activité devient plus lucrative que le simple fait de recueillir les dépôts de la clientèle. P1 et P2 sont (en principe) incompressibles ; dès que la banque n'est plus en mesure de rembourser à 100 % ses clients et ses souscripteurs, elle doit déposer son bilan.
P3 constitue en quelque sorte le "coussin de sécurité" qui protège de la dépréciation des actifs. Lorsque la valeur réelle de A1 et A2 se contracte, c'est au détriment de P3, qu'il convient alors de regonfler (à moins que les règles en vigueur n'autorisent la banque à fermer les yeux sur les dépréciations - voir plus bas). Le moins qu'on puisse dire est que le mode de calcul du ratio de solvabilité Fonds propres/Risques de l'actif (Bâle II) est très arbitraire et très insuffisant.
(En règle générale, les banques disposent de beaucoup moins de fonds propres que les entreprises industrielles. A titre d'exemple, le 31 décembre 2007, BNP Paribas avait 59,4 milliards d'euros de capitaux propres pour un total de bilan de 1.694 milliards, soit seulement 3,5 %, tandis que L'Oréal affichait 13,6 milliards de capitaux propres pour un total de 23,2 milliards, soit 58 %. Un taux de 40 % est courant dans l'industrie, alors qu'on dépasse rarement les 5 ou 6 % dans la finance.)
Dans un monde financier sain d'où la spéculation forcenée serait bannie, A1 et P1 seraient réduits à leur plus simple expression. Le gros du bilan serait alors constitué par A2 (crédits) et P2 (dépôts). C'était le cas avant 1970.
L'effet de levier - moteur de la spéculation
Imaginons le cas d'un spéculateur qui dispose d'un capital de 100.000 €. S'il investit la totalité en bourse (achat d'actions au comptant), il recevra immédiatement ses titres et sera aussitôt débité de leur contre-valeur. S'il les revend trois mois plus tard pour 110.000 €, il aura gagné 10 %.
Supposons à présent qu'il achète ces mêmes actions à terme, avec paiement et livraison dans trois mois. Pour cela, il n'est même pas nécessaire qu'il dispose dès le départ de la totalité de la somme. Pour la banque - ou le courtier - seul importe le risque potentiel inhérent à cette opération, par exemple le risque de voir le cours de l'action chuter de 20 % au cours des trois prochains mois. Dans ce cas, la banque exigera de son client qu'il fournisse une couverture de 20.000 €. En supposant que là aussi le cours ait grimpé de 10 % au bout de trois mois, le spéculateur aura gagné 10.000 €, soit 50 % de sa mise (au lieu de 10 % dans le premier cas).
Grâce à l'effet de levier ou leverage (ici de facteur 5), il est possible d'acheter pour 500.000 € d'actions et de les revendre trois mois plus tard au comptant pour 550.000 €, alors qu'on ne disposait à l'origine que de 100.000 €. Bien entendu, le cours peut baisser. Mais tant que la baisse n'excède pas les 20 % prévus, la banque n'a aucune raison de s'inquiéter. Au-delà, elle demandera au client de compléter la couverture (appel de marge) ; s'il n'est pas en mesure de le faire, la banque débouclera la position. Elle vendra les titres, et le spéculateur malchanceux n'aura perdu "que" 20 % au maximum. (En fait, il aura perdu la totalité de son capital disponible - 5 fois 20 %. L'effet de levier joue dans les deux sens.)
La spéculation est également possible à la vente. Le boursicoteur vendra à terme des actions qu'il ne possède pas. Si le jour de l'échéance, le cours a baissé de 10 %, il les achètera au comptant et empochera son bénéfice. Comme la banque estime que le risque d'une telle transaction n'excède pas, par exemple, 20 % (risque de hausse), c'est ce taux de couverture qu'elle imposera à son client. Avec une mise de 100.000 €, il pourra là aussi, s'il a de la chance, empocher une plus-value de 50.000 €. Dans le cas de figure le plus défavorable, il perdra la totalité de ses 100.000 €.
Bien entendu, les opérations de ce genre - qui peuvent aussi porter sur des devises, de l'or, du pétrole, des céréales, etc. - ne sont pas permises au premier venu. Comme l'opérateur est une "personne digne de confiance", la banque n'est pas trop regardante pour ce qui est de la couverture. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'elle agisse en réalité pour son propre compte - ou du moins pour le compte d'un homme de paille. Il est donc évident que l'effet de levier peut atteindre un niveau beaucoup plus élevé que le quintuple mentionné dans notre exemple ; quant à la mise, elle est souvent bien supérieure à 100.000 €. Ce n'est pas tout à fait "le capitalisme sans capital", comme l'a dit quelqu'un, mais on n'en est pas très loin. Pour certains types de dérivés, le taux multiplicateur est incontrôlable.
En 2008, l'effet de levier de la spéculation professionnelle a largement stimulé les mouvements erratiques constatés sur les marchés financiers - dans un sens comme dans l'autre. L'interdiction passagère des ventes à découvert n'a rien arrangé. Elle n'a fait qu'amplifier la folie des marchés en la retardant légèrement.
Dans un sens plus large, le leverage joue chaque fois qu'un spéculateur engage des sommes qu'il ne possède pas. Même sans spéculation, le recours au crédit permet aux entreprises et aux particuliers d'anticiper l'avenir et de développer des activités qui seraient impossibles autrement - à condition bien sûr qu'on se trouve en période ascendante. Si c'est le cas, une certaine forme de spéculation inconsciente s'instaure presque automatiquement, qui incite les gens à profiter des conditions du marché (exemple : l'immobilier). Le passage à la spéculation pure n'est alors qu'une affaire de temps.
Pour un établissement financier, il est plus rentable d'utiliser des fonds empruntés (dépôts et autres) que des fonds propres. Compte tenu de l'interaction crédits-dépôts (voir plus haut), l'effet multiplicateur est en principe illimité. En pratique, cependant, les banques sont tenues - grosso modo - d'avoir un capital et des réserves totalisant au moins 8 % de leurs engagements de crédit. C'est le seul frein apporté à l'effet de levier, qu'il limite - en principe - à 12 fois 1/2. En réalité, le mode de calcul très judicieux de ce ratio permet aux banques de déclarer 8 % tout en ayant beaucoup moins de fonds propres (environ 3,2 %, soit un levier de 31*, dans le cas de la Citibank en novembre 2008). Il est vrai, toutefois, que depuis quelque temps déjà, le crédit aux entreprises et aux particuliers a atteint sa limite de saturation. Nous sommes maintenant en pleine phase descendante : l'effet de levier joue en sens inverse, c'est le deleveraging.
Autre chose : si un prêt d'un million de dollars nécessite - en principe - 80.000 $ de fonds propres, le même crédit une fois externalisé, titrisé et transformé en actif financier, n'immobilise plus qu'une petite fraction de cette somme, voire rien du tout. Qui plus est, il rapporte autant sinon plus que le crédit direct. Le taux de rendement pour chaque dollar investi s'en trouve donc multiplié - à condition, bien sûr, que la crise financière ne vienne pas abattre ce beau château de cartes.
* La banque Bear Stearns, au moment de sa quasi-faillite, le 17 mars 2008, avait un leverage de 35,5 (11,1 milliards de fonds propres pour 395 milliards d'engagements comptabilisés). Mais son véritable handicap, invisible au bilan, était constitué par 13,4 billions de dollars (13.400.000.000.000) de dérivés financiers. Ce qui signifie en clair que pour chaque dollar de fonds propres, Bear Stearns avait misé 1.207 fois plus au "méga-casino" de Wall Street. C'est un peu comme si le spéculateur mentionné au début ne disposait que de 83 euros pour "garantir" sa transaction de 100.000 euros. Ou, en supposant qu'il ait les 100.000 euros, c'est comme si sa banque lui permettait de s'engager à hauteur de 120 millions. Aucun véritable casino ne se permettrait jamais une telle folie...
Mais il y a pire encore : comme le signale Frédéric Lordon dans cet article paru sur un blog du Monde Diplomatique Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières, l'effet de levier résultant de l'utilisation de fonds empruntés peut se superposer à l'effet de levier créé par un dépôt de marge réduit. Avec 100 dollars en poche, le spéculateur peut ainsi prendre une position de 375.000 dollars (3.750 fois plus).
Bien sûr, un encours de 13,4 billions de dérivés n'entraîne pas automatiquement 13,4 billions de pertes effectives. Mais si l'on s'en tient au taux de 10 % constaté dans le cas de la Société Générale (affaire Kerviel - janvier 2008), cela fait 1.340 milliards de dollars détruits (120 fois les capitaux propres). A titre de comparaison, le PIB américain se monte à environ 15 billions de dollars.
Quoi qu'il en soit, il serait naïf de penser que les banques encore actives et apparemment saines (Citigroup et consorts) sont moins exposées que ne l'était Bear Stearns avant de sauter.
Glissade vers l'anarchie financière
Dans les années 1960, les risques bancaires sont encore clairs et faciles à maîtriser. Une banque, en particulier une banque commerciale, ne court guère le danger de faire faillite. D'une part, parce que le mode d'évaluation des critères de liquidité et de solvabilité est encore assez simple et transparent, d'autre part parce que la palette des transactions possibles est très restreinte.
Sur le marché des valeurs mobilières, on opère le plus souvent au comptant (débouclement immédiat titres contre argent) ou à la rigueur à terme (en général débouclement fin de mois). Les opérations plus "osées" (options) sont plus rares. Les fonds de placement (SICAV) sont encore très rudimentaires.
Même chose, en gros, sur le marché des changes, où les instances de contrôle veillent à ce qu'il y ait du concret derrière chaque transaction (commerce extérieur, investissements autorisés, paiements légaux). La spéculation pure et simple est difficile, sinon impossible ; les marchés ne s'y prêtent pas, ou assez peu.
Mais avec la libéralisation progressive du secteur bancaire, n'importe qui se met à faire n'importe quoi. Les distinctions entre les divers types d'établissements de crédit commencent à tomber. On s'aventure de plus en plus fréquemment en terrain inconnu.
On quitte aussi peu à peu le domaine du réel où l'acheteur opérant sur les marchés financiers acquiert des valeurs existantes : parts de capital dans une société (actions), créances sur l'Etat, un organisme public ou une entreprise privée (obligations), avoirs en monnaie étrangère (devises), etc... Avec les dérivés, on s'enfonce dans le monde de la spéculation pour la spéculation. On parie sur la valeur future d'une action, d'une obligation, d'une monnaie, sans qu'il soit nécessaire de posséder ces valeurs. On parie sur le niveau d'un indice boursier (la valeur moyenne d'un groupe d'actions), sur des écarts de cours, sur des variations de taux d'intérêts, sur l'évolution de critères souvent incompréhensibles et parfois fictifs. La finance se dématérialise toujours plus, mais les gains et les pertes qu'elle génère sont tangibles et peuvent atteindre des sommets inégalés. Quelqu'un a dit que les dérivés sont à la bourse classique ce que le PMU est à l'élevage des chevaux : la réalité est bien pire...
Finalement, à partir des années 1980, trois facteurs vont contribuer à la fragilisation des marchés financiers :
-la création incessante de nouveaux instruments spéculatifs* et la croissance inflationnaire de ces dérivés : contrats à terme (forwards, futures, swaps) portant sur des valeurs mobilières, des devises, des taux d'intérêts, des indices boursiers ou des marchandises (produits agricoles, matières premières, métaux) ; contrats optionnels** à fort effet de levier permettant de gagner un multiple de sa mise (ou de tout perdre) ; dérivés de crédit (credit default swaps ou CDS)...
* A l'origine, certains de ces instruments ont été créés dans le but de protéger leur acquéreur contre des risques normaux découlant d'opérations concrètes non-spéculatives (par exemple, dans un contexte de baisse de la monnaie américaine, un exportateur vend à terme dès aujourd'hui des dollars qu'il ne recevra que dans trois mois ; ou encore, un prêteur fait assurer une créance sur l'étranger qu'il estime assortie d'un certain risque). C'est un domaine où la banque côtoie l'assurance.
-Le CDS n'a pratiquement plus rien à voir avoir ces préoccupations légitimes. C'est un contrat financier dans lequel est impliqué un "vendeur de protection" étranger au secteur réglementé des assurances. Généralement dépourvu de capitaux, ce vendeur n'a qu'un souci : toucher sa prime. On imagine la catastrophe lorsque les défaillances soi-disant couvertes par ces credit swaps, commencent à s'accumuler. En juin 2008, F. William Engdahl (Global Research) estime que sur un volume total de CDS de 62.000 milliards de dollars, 1.200 milliards sont susceptibles de sauter : Credit Default Swaps - Next Phase of an Unravelling Crisis. Engdahl rappelle que c'est Alan Greenspan, chef de la Fed de 1987 à 2005, qui a permis la prolifération incontrôlée des CDS.
** Les options et le 11 septembre : Délits d'initiés.
Dans le domaine spéculatif, on peut aussi combiner les indices et jouer sur les différences de cours, ou mélanger les genres en se lançant par exemple dans les options sur swaps (les swaptions). On peut même jongler avec les droits d'émission créés dans la foulée de l'hystérie climatique.
Sans oublier les opérations de grande envergure (emprunts obligataires, émissions, fusions, acquisitions, capital-risque, private equity, hedge funds...) ; les innombrables fonds de placement ; les produits concoctés par les compagnies d'assurances (toujours plus difficiles à distinguer des banques) ; les titres adossés à des actifs (ABS - asset backed securities) ; les obligations* titrisées comme les CDO (collateralized debt obligations) ou leur équivalent hypothécaire CMO (collateralized mortgage obligations) ; les véhicules d'investissement structurés (SIV) et autres véhicules ad hoc (SPV - special purpose vehicles), dont la raison d'être est d'acheter à tour de bras des créances douteuses dont personne ne voudra plus quelque temps plus tard (par exemple, les subprimes hypothécaires américains) pour les remodeler sous une forme présentable et les revendre avec profit à des banques qui ignorent tout du contenu. Cette redistribution du risque de crédit, cette transformation de risques connus, mesurables, contrôlables, en titres financiers abstraits et dématérialisés, échappant à toute évaluation comptable sérieuse, rend possible - et probable - une catastrophe financière généralisée.
* Souvent, les emprunts obligataires contenus dans les CDO sont assurés par des "bond insurers", ce qui accroît la confiance en ces instruments (meilleure notation) et facilite leur écoulement sur le marché. Lorsque les défaillances se multiplient, il est évident que les assureurs (AMBAC, MBIA...) sont eux-mêmes en difficulté et que les autres titres dont ces compagnies "garantissent" le remboursement plongent à leur tour : c'est ce qui se passe aux Etats-Unis, début 2008.
On estime que la part des transactions purement spéculatives, sans aucune nécessité économique et motivées uniquement par l'appât du gain, atteint déjà plus de 90 % de l'ensemble des flux monétaires. Et encore, toutes les opérations ne donnent pas lieu à un mouvement de fonds équivalent, loin de là... Selon le milliardaire américain Warren Buffett, qui sait de quoi il parle, la bulle des dérivés représentait, à elle seule, plus de 500 billions de dollars (500.000 milliards) à l'échelle mondiale, en 2007*. Que va-t-il arriver lorsque cette bulle éclatera et qu'il sera nécessaire d'éponger les pertes ? A quel pourcentage du total se monteront ces pertes : 2 %, 5 %, 10 % ?... (A titre de comparaison, le PIB américain est d'environ 15 billions de dollars.) En principe, les spéculateurs doivent fournir une couverture, en monnaie ou en titres, correspondant au risque probable. Lorsque le risque croît ou que la valeur des titres baisse, on leur demande un versement supplémentaire (appel de marge). Si la "rallonge" n'est pas versée, la position est débouclée et la perte potentielle devient une perte réelle. Que les liquidités commencent à faire défaut ici et là, et c'est l'avalanche qui menace...
* Soit 500 fois plus qu'en 2001. Dans son rapport de décembre 2007, la Banque des Règlements Internationaux (BRI), Bâle, donne un chiffre total de 516 billions de dollars et évalue le risque potentiel à 11 billions. On peut toutefois se demander pourquoi ce risque resterait limité à 2 %... En décembre 2009, selon la BRI, le total des dérivés en circulation est de 605 billions : on voit que les financiers de Wall Street continuent d'alimenter la crise.
William H. Gross, financier et milliardaire américain lui aussi, estime que la méga-bulle des dérivés constitue une sorte de système bancaire parallèle, incontrôlé et incontrôlable : "C'est le plus gigantesque marché noir du monde et, potentiellement, une arme financière de destruction massive..."
Pour les banques anciennement commerciales et aujourd'hui "universelles", les risques découlant des instruments spéculatifs ne cessent de gagner en importance par rapport aux risques de crédit proprement dits. Alors qu'autrefois la demande de crédit bancaire dépassait de beaucoup l'offre, les banques ont de la peine, quelques décennies plus tard, à trouver des emplois pour leurs ressources disponibles. Elles tendent à accumuler dans leurs actifs des "produits" toujours plus sophistiqués... et toujours plus dangereux.
Dans les années 1990, les banques (en particulier les banques américaines) se sont mises à externaliser une bonne partie de leurs risques de crédit. Au lieu de consentir des prêts directs à leur clientèle modeste, elles ont laissé des intermédiaires ou courtiers (brokers) le faire à leur place, ces derniers se refinançant auprès d'investisseurs spécialisés dits indépendants (New Century Financial, par exemple).* Conséquences pour les banques : bilan "ravalé", risque amoindri, commission assurée. Conséquences pour les investisseurs (souvent liés aux grandes banques) : titrisation des créances, c'est-à-dire transformation des prêts en instruments financiers que l'on placera avec profit sur le marché après notation positive par les rating agencies (également liées aux grandes banques). Comme les banques en question, en quête d'emplois supposés rentables, sont les premières à acheter les nouveaux titres financiers ainsi créés, nous avons affaire à un véritable retour de boomerang. Les risques de crédit "externalisés" reviennent ainsi à l'expéditeur, mais ne sont plus cette fois comptabilisés comme tels. Bien entendu, les banques qui sont à l'origine de cette procédure ne sont pas les seules - loin de là - à acquérir ces titres. Des milliers d'autres établissements, aussi avides que naïfs, se lancent également dans la course et tombent dans le panneau - globalisation obige.
* Les entreprises externes ne sont pas soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques et ne s'embarrassent donc pas de constituer des dossiers très étoffés - au diable la "bureaucratie"... Bien souvent, les acheteurs de créances hypothécaires qui font vendre les biens immobiliers de leurs débiteurs insolvables, ne possèdent même pas de titre et se contentent de déclarer "sur l'honneur" qu'ils ont "égaré" le document en question. La plupart du temps, les tribunaux ferment les yeux.
En quelques années, la part relative des actifs financiers dans les bilans de banques autrefois commerciales a grimpé en flèche, celle des crédits à la clientèle a baissé. Un coup d'œil sur les comptes de la Société Générale donne l'image suivante :
Au cours des quatre années précédant la crise (2002 à 2006), le total du bilan a presque doublé (+ 90 %). Mais si les crédits n'ont augmenté "que" de 43 % (ce qui est déjà beaucoup), les actifs financiers, eux, ont plus que triplé (+ 212 %). Leur part est passée de 34 % à 56 % du total ; celle des crédits a baissé de 40 % à 30 % (bien que le volume des crédits ait augmenté en valeur absolue). Si l'on remonte encore plus loin dans le passé, on constate qu'en 1998 les actifs financiers ne représentaient que 22 % du total : 83 milliards sur 384. (Et à tout cela il faudrait ajouter les risques financiers ne figurant pas au bilan.)
Une telle explosion de l'activité purement spéculative a quelque chose de malsain. Elle prouve que la Société Générale, comme d'ailleurs toutes les autres banques "grand public", n'a plus pour fonction de financer l'économie réelle et de répondre aux besoins de ses clients ; elle joue tout simplement avec l'argent qui lui a été confié.
Autre aspect inquiétant : l'accumulation d'actifs financiers nécessite, en contrepartie, moins de fonds propres que s'il s'agissait de crédits. La solvabilité réelle de la banque s'en trouve affectée, même si les ratios officiels sont respectés.
(Entre 2006 et 2010, la tendance s'est un peu "calmée", mais sans revenir à la "normale" de 2002. En 2010, les crédits représentent 35 % du bilan, les actifs financiers 50 %. On ne peut pas dire que la Société Générale ait tiré les leçons de la crise.)
Le retard et l'inefficacité des procédures de contrôle face à l'explosion des marchés : les autorités chargées de la surveillance des marchés et des établissements financiers sont complètement dépassées par les événements. Elles se contentent d'appliquer la loi ou le règlement, mais la loi est toujours à la traîne. Le fameux "législateur" veille d'ailleurs à laisser les coudées franches aux spéculateurs, au nom du "libéralisme" et de la globalisation. (Il ne légifère pas vraiment, se contentant d'approuver - sans les comprendre - des décisions prises ailleurs sans débat démocratique.)
Quant au contrôle interne des banques, on a vu en janvier 2008 ce qu'il valait : Société Générale : de qui se moque-t-on ? Quand un employé relativement modeste (salaire brut annuel : 100.000 euros - une broutille à côté de ce que gagnent les vrais "golden boys") parvient à accumuler (seul ?) des positions spéculatives de 50 milliards débouchant sur des pertes de 5 milliards*, les banques ont un sérieux problème - et leurs clients aussi.
* Pour un total de bilan de 956 milliards d'euros et un résultat net de 5,8 milliards avant le scandale. (Des plaisantins ont créé une nouvelle unité de mesure dans le domaine bancaire : le kerviel, représentant l'équivalent de 5 milliards d'euros de perte. A partir de combien de kerviels peut-on parler de cataclysme financier ? A partir de 1.000 kerviels, soit 1 kilokerviel ou 1 kk - c'est le cas de le dire...)
Jérôme Kerviel, bouc émissaire du capitalisme financier
par Paul-Eric Blanrue.
[Kerviel sera condamné en octobre 2010 - voir plus bas.]
L'opacité des marchés, c'est-à-dire l'impossibilité, même pour les spécialistes et les initiés, d'avoir une vue exacte de la situation à un moment donné : comment le pourraient-ils puisque les banques qui rachètent des titres basés sur des créances douteuses (ou participent à leur émission) ne prennent pas toujours la peine de les comptabiliser. On a beau savoir lire un bilan, on ne pourra jamais y trouver ce qui n'y est pas.* Aujourd'hui, n'importe quel banquier achète n'importe quoi sans laisser de traces. On a vu des caisses d'épargne de Rhénanie se lancer dans l'immobilier en Arizona (où elles n'y connaissent strictement rien) et annoncer, toutes penaudes, qu'elles avaient perdu tant et tant de milliards en voulant jouer les "global players". En 2008, il est devenu impossible d'évaluer la solidité d'une banque, car personne ne sait exactement quelles "bombes à retardement" elle a éventuellement "oublié" de faire figurer dans ses livres. Les rating agencies chargées de la noter (comme par exemple Fitch Ratings, Moody's ou Standard & Poor's) ne sont absolument plus fiables.** Conséquence : plus personne ne veut plus prêter d'argent à personne. Ce qui ressemble à une crise passagère de liquidité, surmontable avec l'aide de l'Etat et des banques centrales, pourrait bel et bien se transformer en effondrement complet.
* Certains risques qui ne figurent pas au bilan sont néanmoins repris "hors-bilan", c'est-à-dire en quelque sorte "en marge" de celui-ci. C'est le cas, entre autre, des engagements par signature (cautions ou garanties fournies par la banque). D'autres éléments, "externalisés" dans le but d'alléger les comptes, ne figurent ni dans le bilan ni hors-bilan. Ce qui ne signifie pas, malheureusement, qu'ils aient complètement disparu. Avec la crise financière actuelle, on découvre au contraire presque quotidiennement des exemples de risques transmis (légalement ou pas) à des sociétés externes qui ne le sont pas vraiment, ou vis-à-vis desquelles la banque "cédante" a pris un engagement bien réel, quoique réputé inexistant et pour lequel elle n'a pas prévu de fonds propres en contrepartie.
** Ironie du sort, avant de fournir une évaluation erronée sur la solvabilité de la banque en question, les agences de notation l'ont elle-même induite en erreur en lui recommandant l'acquisition de produits financiers foireux.
Lorsque Citigroup, le numéro un mondial de la finance, annonce au printemps 2008 des pertes de 18 milliards de dollars au cours d'un seul et même trimestre, on peut se consoler en se disant que cette somme est ridicule face à un total de bilan de 2.200 milliards. Le problème, c'est que personne ne connaît l'ampleur des pertes réelles : et si elles étaient dix fois, vingt fois ou cent fois plus élevées ?... La garantie des dépôts ne servira pas à grand-chose le jour ou le géant se sera écroulé, entraînant tout le monde dans sa chute. Les profiteurs, pour ne pas dire les organisateurs de la débâcle, sauront pour leur part tirer leur épingle du jeu.
Plan organisé ?
On entend souvent l'expression "capitalisme de casino" quand il est question de la situation financière actuelle. En fait, la réalité est bien pire, car aucun casino de Las Vegas n'a jamais offert autant de possibilités que les marchés financiers. Aux yeux d'un banquier de Wall Street ou de la City, la roulette et les machines à sous, c'est bon pour les débutants.
En cas de défaillance, on ne sanctionne que les lampistes et les boucs émissaires. Et comme la responsabilité personnelle des dirigeants n'est jamais engagée, ces messieurs n'ont aucune raison de faire preuve de modération. Sur le plan criminel, le braquage d'une banque est tout à fait insignifiant en comparaison de la fondation d'une banque, disait en substance Bertolt Brecht, dans les années 1920-1930. Que dirait-il aujourd'hui ?...
"Aucune autre activité n'a un talent comparable pour privatiser les gains et socialiser les pertes", rappelle Martin Wolf (Financial Times) à propos de la mafia de l'argent.
En l'espace de cinquante ans, on est tombé de Keynes à Milton Friedman, du dirigisme au laissez-faire, de l'Etat modérateur à l'Etat complice, de la défense du service public au pillage organisé.
Ce qui se passe sur les marchés financiers s'intègre bien entendu dans le plan d'ensemble baptisé mondialisation. C'est par là que viendra la catastrophe qui permettra une répartition radicale des richesses du bas vers le haut.
Que faire ?
Début 2008, avec le scandale de la Société Générale et la crise financière mondiale qui commence, on entend souvent dire qu'il faut réglementer les banques. Oui, bien sûr... Le problème, malheureusement, résulte moins de l'absence de réglementation que d'un excès de règles favorables à la spéculation.
Le secteur bancaire et financier est un de ceux où les compétences nationales ne sont plus du tout demandées. La France a perdu toute souveraineté dans ce domaine depuis qu'elle a abandonné sa monnaie et qu'elle s'en remet à des autorités extérieures aussi peu élues que contrôlables : Commission européenne, Banque centrale européenne (BCE), Comité de Bâle de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), etc.
Une décision ayant trait, par exemple, au mode d'évaluation de la solvabilité des banques françaises (et des banques étrangères en France) ne peut pas se prendre à Paris, ni même à Francfort ou à Bruxelles, mais seulement à Bâle. La BRI étant l'émanation des treize plus grandes banques centrales du monde, dont celle des Etats-Unis (la Fed), on imagine ce qui se passerait si la France proclamait son intention de faire cavalier seul. Comment réagirait le fameux Board of Governors de Washington ? (voir plus haut)
Un retour à la situation des années 1970, où les grandes banques françaises étaient encore une sorte de service public à l'abri des appétits carnassiers de la finance internationale, est parfaitement utopique sans modification radicale de l'ensemble des conditions économiques et politiques. Evidemment, tout se tient ; une mutation dans un secteur donné n'est pas pensable sans mutations dans tous les autres.
A moins qu'une révolution aussi radicale que celle de 1789-1793 ne vienne rétablir la souveraineté nationale en y ajoutant une très forte composante sociale, tout est programmé pour continuer dans le sens de la globalisation ultra-capitaliste. Une solution réelle exigerait que la France résilie unilatéralement tous les traités supranationaux qui vont à l'encontre de ses intérêts, à commencer par le traité européen : difficile à imaginer...
Un pays souverain (ou un groupe de pays souverains), sans même abandonner le cadre du système actuel, prendrait quelques mesures de bon sens : stopper le laissez-faire sur les marchés financiers et contrôler strictement l'activité bancaire, geler les dérivés existants et empêcher qu'il s'en crée de nouveaux chaque jour, garantir effectivement les dépôts des particuliers et des PME. Ce ne serait pas du "socialisme", mais tout juste du "dirigisme" comparable à ce que faisaient Roosevelt en 1935 ou de Gaulle en 1945. Et pourtant, rien de tel ne sera fait en 2008-2011.
(Une transformation socialiste irait bien sûr infiniment plus loin : nationalisation de l'ensemble du système bancaire ; gestion démocratique excluant un recyclage des parasites de la finance privée ; restructuration en fonction de l'intérêt national ; prise en compte des besoins de l'économie réelle et du secteur public restauré et étendu ; plus de course au profit au détriment des utilisateurs et du personnel ; fermeture pure et simple de la bourse...)
Voir également plus bas la solution proposée par Webster Tarpley en octobre 2011.
Quatre principes et neuf propositions pour en finir avec les crises financières - par Frédéric Lordon (économiste, directeur de recherche au CNRS).
D'autres économistes, comme Maurice Allais (en France) ou Joseph Huber (en Allemagne) voient la cause de la crise dans le fait que l'Etat a perdu depuis bien longtemps son privilège de "battre monnaie". Ils proposent donc une réforme du système financier qui restituerait aux pouvoirs publics ce monopole disparu. Sans entrer dans les détails - ce qui mènerait beaucoup trop loin - disons que l'un et l'autre veulent retirer aux banques toute possibilité de création monétaire. Allais reste assez vague sur les conséquences pratiques de sa théorie ; Huber veut instaurer un "pouvoir monétatif" à l'instar des pouvoirs déjà existants (législatif, exécutif, judiciaire).
Le problème, dans les deux cas, c'est que pour aboutir, il faut remettre entre les mains d'une instance étatique toutes les decisions concernant les actes créateurs de monnaie, à commencer par le crédit bancaire sous toutes ses formes. Mais parallèlement, on ne touche pas à l'initiative privée en matière économique ou financière. C'est un peu la quadrature du cercle. Dans un passé pas très lointain, il a existé des pays où la totalité de la masse monétaire était générée par l'Etat ou ses institutions, mais ces pays n'étaient pas capitalistes et l'initiative individuelle y était presque totalement inconnue.
Comme ni Allais ni Huber n'ont l'intention de recréer une sorte de RDA dans leurs pays respectifs (pas même une RDA "améliorée"), et comme ils ne réclament ni pour la France ni pour l'Allemagne le droit à l'initiative individuelle des Etats, droit que la mondialisation a aboli, leurs projets ne peuvent pas vraiment être pris au sérieux, même s'ils contiennent un certain nombre d'éléments positifs.
Le mythe bancaire : un article intéressant, mais n'allez surtout pas croire que le problème sera résolu grâce à des élections.
S'il n'y a probablement pas de solution générale et collective dans le cadre du système existant, peut-on au moins envisager la possibilité d'une solution individuelle ?... Magot enterré dans le jardin ?... Liasses de billets cousues dans un matelas ?... Si tout le monde opte pour le papier-monnaie, il y a fort à parier que l'hyperinflation ne se fera pas attendre... L'or serait-il un remède efficace ?...
Quoi qu'il en soit, attention si votre banque vous recommande un placement imbattable ou vous conseille d'investir dans la pierre. Le gars qui vous propose ça pense avant tout à son bonus, et il n'y voit sans doute pas plus clair que vous et moi...
LA CRISE FINANCIÈRE DE 2007-2012
"Il est temps de réformer les retraites"
Les banques et autres organismes financiers comparables ne sont pas les seuls intervenants sur les marchés. Les investisseurs institutionnels ou "zinzins" (fonds de pension, caisses de retraite) jouent un rôle considérable, surtout aux Etats-Unis, où l'assurance vieillesse, comme l'assurance maladie, est une affaire privée. Aux USA, tout ce que les travailleurs économisent en prévision de leurs vieux jours, passe automatiquement par le marché financier et reste à la merci d'un effondrement boursier. Et lorsque l'entreprise qui gère les fonds fait faillite, ou que ses dirigeants disparaissent avec l'argent, l'épargnant-retraité n'a plus qu'à se tirer une balle dans la tête (voir le scandale Enron, en 2001). C'est ce système "moderne et idéal" que les "réformateurs" européens prévoient d'instaurer pour leurs salariés.
La déroute annoncée du système de retraites par capitalisation
Endettement
Début 2008, la dette publique des Etats-Unis se monte à environ 9,5 billions de dollars (+ 600 milliards chaque année ou 1,7 milliard chaque jour*), ce qui représente environ 65 % du PIB annuel, soit proportionnellement moins que la France (dette publique française : 1,4 billion d'euros ou 2,2 billions de dollars). La dette publique US s'élève à 32.000 dollars par habitant, la dette publique française à 35.000 dollars. De ce côté-là, la France a donc déjà dépassé le niveau américain (même chose pour l'Allemagne). On notera que le volume "astronomique" de la dette publique est tout relatif quand on le compare aux 500 billions de dollars de la bulle des dérivés (voir plus haut).
* C'est un peu moins que les dépenses militaires (700 milliards de dollars par an ou 2 milliards par jour). Toutefois, avec l'adoption début octobre 2008 du plan de sauvetage de 850 milliards, la dette publique américaine grimpera à 11 billions en 2009, soit plus de 70 % du PIB. Le 12 octobre 2008, on en est déjà à 10.276.307.126.813 dollars et 97 cents - voir U.S. National Debt Clock. De septembre 2007 à septembre 2008, on a enregistré une augmentation de 1.200 milliards, soit 3,3 milliards de plus chaque jour (le double de l'accroissement des années précédentes). Chacun Américain "doit" à présent 33.700 dollars. Les USA sont sur le point de rattraper la France (à moins que ce ne soit déjà fait - tout dépend du taux de conversion euro/dollar).
Début juillet 2009, le compteur indique 11,5 billions de dollars. En novembre, il dépasse les 12 billions, ce qui correspond à une augmentation de 1,8 billion en un an (5 milliards de dollars par jour). Un an plus tard, fin 2010, on en est à 13,9 billions (+35% en deux ans). Début août 2011, l'endettement public atteint le maximum "autorisé" de 14,3 billions, de sorte qu'il est nécessaire de porter ce plafond à 16,4 billions (en attendant le prochain relèvement qui ne saurait tarder).
Pour ce qui est de la dette extérieure (publique + privée), la situation est tout à fait différente (déficit accumulé de 13 billions de dollars, soit environ 85 % du PIB annuel, aux Etats-Unis ; léger excédent en France). Dans des conditions normales, lorsqu'un pays accumule les déficits extérieurs, sa monnaie ne tarde pas à en pâtir. Dans le cas des USA, il a fallu attendre assez longtemps avant que ce principe ne se vérifie. En effet, le dollar étant une monnaie de réserve, et pour beaucoup une monnaie refuge, le monde entier, en effectuant des placements ou des investissements aux USA, contribue à rétablir l'équilibre et à cacher le déficit extérieur permanent. La Chine, à elle seule, y contribue pour 10 % (excédent de 1.300 milliards de dollars) mais la part des détenteurs de pétrodollars est bien plus élevée. La crise financière touche ces créanciers dans la mesure où leur argent était placé dans des établissements en faillite ou en difficulté. Le bruit court, en octobre 2008, que la Chine a perdu des sommes considérables en l'espace de quelques semaines, et elle n'est certainement pas un cas unique. A lui seul, le trou laissé par Lehman Brothers à l'étranger représenterait plusieurs centaines de milliards de dollars. Pour les Etats-Unis, la crise est une manière "élégante" d'effacer une partie de la dette extérieure.
L'endettement des ménages aux USA totalise 14 billions de dollars, soit 47.000 dollars par habitant (trois fois plus qu'en France). On encourage systématiquement les Américains à s'endetter, surtout dans l'immobilier bien sûr, mais aussi dans le domaine du crédit à la consommation, quitte à les saigner à blanc lorsqu'ils ne sont plus assez solvables (par exemple parce que les taux relativement avantageux au départ, augmentent très rapidement). La crise des "subprimes" vient de là. Le mot "subprimes" est d'ailleurs un euphémisme qui désigne les débiteurs dont le standing n'est pas de premier ordre (prime debtors) mais moindre (sub). En matière de crédit à la consommation, le mode d'endettement le plus courant aux Etats-Unis est le découvert lié à l'utilisation d'une carte de crédit (c'est aussi le plus cher). 50 millions de détenteurs de cartes de crédit doivent un total de 600 milliards de dollars* (12.000 dollars chacun, en moyenne). Et il existe encore d'autres formes de crédit personnel, souvent inconnues ailleurs, par exemple le crédit étudiant qui permet de payer ses frais d'études (en moyenne, plus de 40.000 dollars par emprunteur). Toutes ces bulles de crédit ne demandent qu'à éclater...
* Selon des données de juillet 2008, ce chiffre serait entre-temps passé à un billion de dollars (1.000 milliards).
A part ça, tout est pareil...
L'augmentation vertigineuse de la dette des ménages a injecté dans l'économie américaine une masse de liquidités qui a permis de maintenir artificiellement la croissance à un niveau élevé. Les particuliers croyaient s'enrichir grâce à l'immobilier ; en réalité, ils s'appauvrissaient.
Par exemple, une famille empruntait 400.000 dollars afin de s'acheter une maison en valant 500.000. Trois ou quatre ans plus tard, la valeur du bien étant passé à 750.000 dollars, le banquier encourageait ses clients à emprunter 200.000 dollars de plus pour s'offrir, disons, une grosse voiture, des biens de consommation, un voyage autour du monde ou les frais d'études des enfants. Avec une hypothèque supplémentaire, aucun problème... Et puis, quelque temps plus tard, l'immobilier plonge, le banquier demande à son client de rembourser plus vite ou de fournir de nouvelles sûretés, il augmente ses taux - normal puisque l'emprunteur est moins solvable. C'est le début de la catastrophe, surtout si le client vient à perdre son emploi. Finalement, la famille se retrouve à la rue, les mains vides... Le banquier, le promoteur immobilier, le marchand de 4x4 et tous les autres gonfleurs de PIB, eux, ont fait des affaires en or. Malgré la mauvaise conjoncture, ils ont le temps de voir venir en attendant la prochaine bulle.
La dette des entreprises américaines, qui provient principalement de crédits bancaires ou d'emprunts obligataires des grandes compagnies sur le marché financier, s'élève à environ 12 billions de dollars.
En additionnant dette publique, dette des ménages et dette des entreprises, on arrive à un total de 36 billions de dollars environ (dont 13 billions vis-à-vis de l'étranger). Il s'agit là de la dette concrète et palpable, résultant d'opérations réelles. Si l'on voulait y ajouter l'endettement net provenant de transactions purement financières et spéculatives, impossibles à chiffrer de manière réaliste, nul ne sait à quel total on arriverait.
On cite souvent le chiffre de 50 billions lorsqu'il est question de l'endettement global des USA, la dette du secteur financier y figurant pour 14 billions. Mais comme ce dernier chiffre est un minimum absolument arbitraire, le total général pourrait aussi bien être 2, 3 ou 10 fois plus élevé (à comparer au PIB annuel d'environ 15 billions de dollars). 50 billions de dollars répartis sur 300 millions d'habitants, cela donne 167.000 dollars par tête. Le fardeau effectif est peut-être de 300.000 ou 500.000 ou 1.000.000 de dollars par habitant - qui sait ?...
Lorsque la crise éclatera pour de bon et que le niveau réel d'endettement sera révélé, il y aura nécessairement une coupe brutale (et pas seulement aux Etats-Unis). L'annulation d'une grande partie de la dette financière ruinera de très larges couches de la population (les fameuses "classes moyennes"), les faillites se multiplieront, l'Etat et les collectivités locales deviendront à leur tour insolvables, entraînant sans doute l'effacement ou le gel de leur dette. Une chose est certaine : on ne fera pas de cadeaux aux "ménages", leur dette ne sera certainement pas annulée, ils seront les seuls à faire les frais de la crise - du moins 90 % ou 95 % d'entre eux. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Argentine en 2001-2002 et d'élever le tout à la puissance 10.* Les vraies "réformes libérales" n'ont pas encore eu lieu.
* Il est facile d'imaginer les conséquences sociales et politiques d'un tel bouleversement : incroyable recrudescence de la criminalité, insécurité totale, dictature militaire, disparition des dernières "libertés démocratiques", intensification du terrorisme d'Etat et de la guerre permanente pour détourner l'attention des vrais responsables, effondrement général permettant enfin la construction accélérée du nouvel ordre mondial tant attendu par l'oligarchie et ses pilotes néo-cons.
La dette publique, source d'enrichissement des banques privées
De nos jours, l'Etat, qui détient en théorie le monopole "régalien" de création de monnaie, n'a en réalité qu'une influence marginale sur ce processus. La banque d'emission (qu'elle soit un organisme étatique ou, comme la Fed, une institution privée agissant pour le compte de l'Etat) génère tout juste 7 % de la masse monétaire - voir plus haut.
Le pouvoir de la Banque Centrale sur l'émission monétaire par Jean Bayard.
La masse monétaire (article de Wikipédia) représente en quelque sorte la part des richesses qui existe sous forme liquide (ou quasi liquide) et permet de faire tourner l'économie (et accessoirement la spéculation).
Dans une économie socialiste (ou capitaliste mais fortement étatisée, comme la France d'avant les privatisations), l'Etat finance lui-même ses investissements et ses dépenses courantes (ou s'efforce de le faire), utilisant prioritairement les fonds drainés par les établissements financiers du secteur public et les organismes spécialisés (en France : Caisse des Dépôts, Crédit National, etc.). En cas de besoin (ce qui arrive assez souvent en France), il emprunte aussi directement sur les marchés financiers privés (émission d'emprunts obligataires).
Les partisans de la privatisation ont toujours prétendu que le recours de l'Etat aux fonds publics équivalait à activer la "planche à billets" et à attiser l'inflation. Pour résoudre ce "problème", il fallait obliger l'Etat à emprunter sur le marché "libre" (et par la même occasion "libérer" au profit du secteur privé les sources publiques de financement).
Cet argument fallacieux ne tient pas compte du fait que les crédits consentis par des banques privées représentent une création de monnaie, donc une cause potentielle d'inflation. Depuis que la privatisation et la "libéralisation" ultracapitaliste se sont imposées partout, on voit que la dette publique a crû de façon anarchique pour le plus grand profit du secteur privé. L'endettement à outrance (qui conduit assez souvent à la ruine) est une source inépuisable de profits pour les banques privées, non seulement quand les pigeons sont des particuliers, mais aussi et surtout quand c'est l'Etat qui emprunte. Alors qu'il serait plus rationnel et moins onéreux d'exclure le secteur privé du financement des dépenses publiques, on assiste de manière toujours plus dramatique au pillage des ressources communes par les prédateurs du privé.
Sans même parler de l'aspect social et humain de la question, il est évident que la privatisation coûte plus cher à la société que la gestion publique (une véritable gestion publique, et non une gestion confiée aux représentants du secteur privé, comme ce fut le cas en France, en Italie et ailleurs).
On entend souvent dire qu'il convient de se serrer la ceinture pour ne pas léguer un monceau de dettes aux générations futures. Bien entendu, ce slogan absurde occulte totalement la manière dont la dette publique est générée. Il passe d'ailleurs également sous silence le fait que les actifs qui seront eux aussi légués aux générations futures dépassent de beaucoup le passif. En réalité, ce n'est pas la société de demain qui devra payer pour la nôtre, mais la masse de notre société qui doit payer aujourd'hui pour enrichir davantage quelques milliers de parasites. Et à moins d'un sursaut général, la société future subira un sort similaire - sinon pire.
Sur la création de monnaie, le racket financier, l'endettement selon Ségolène Royal et François Rabelais, lire ici plusieurs articles de Jacques Cheminade (sur le site de Solidarité et Progrès, proche de Lyndon LaRouche).
Voir aussi : Endettement public et idées préconçues.
Le grand secret : l'endettement des Etats-Unis comparé à l'endettement français par François Asselineau.
"Le discours lancinant des européistes sur 'le niveau de dette publique insupportable que l'on va laisser à nos enfants' est une formule à l'emporte-pièce complètement irréfléchie, une propagande scandaleusement réductrice et biaisée... La donnée essentielle pour juger de la santé financière d'une nation, c'est le niveau d'endettement total de tous ses agents économiques : l'Etat et les collectivités publiques, mais aussi les ménages et les entreprises... La France doit reconquérir sa souveraineté économique et financière pour décider librement du niveau d'intervention étatique dont notre pays a besoin."
(Les chiffres cités par l'auteur diffèrent parfois légèrement des nôtres - c'est une question de source ou de taux de conversion dollar/euro. Aucune divergence quant au fond.)
La cause de l'endettement de la France, c'est la loi Rothschild. Cette loi de 1973 interdisant à la Banque de France de financer le Trésor public, a été renforcée en 1992 par une clause du traité de Maastricht qui empêche les membres de l'UE d'emprunter auprès de leurs banques centrales.
Conséquence : une explosion de la dette, surmultipliée par les intérêts que les Etats doivent verser aux usuriers du privé.
Indépendamment des cadeaux purs et simples dont bénéficie la haute finance, on peut mesurer, en 2009, à quel point les prêts de l'Etat enrichissent les banques privées. Wall Street se voit inonder d'argent public pratiquement gratuit (coût entre 0 et 0,25 %), alors que l'Etat lui-même, pour financer ses besoins, doit emprunter à ces mêmes banques (ou par leur intermédiaire) à des taux jamais inférieurs à 3,5 ou 4 %. Théoriquement, l'écart s'explique par les différences d'échéances : court terme pour les prêts consentis aux banques privées, plus long terme pour les sommes empruntées par le secteur public. Mais en pratique, le court terme ne mérite pas ce nom, car les avances sont renouvelables - et renouvelées indéfiniment. (En Europe, la situation n'est guère différente, si ce n'est que le taux de la banque centrale est légèrement plus élevé : 1 %.)
Cours du dollar
La dépréciation du billet vert a été constante ces dernières années, mais n'a encore rien de très dramatique en mars 2008 (1,58 dollar pour un euro). Certes, si on compare ce cours à celui de 2002 (0,80 dollar pour un euro), la baisse est impressionante, mais il ne faut pas oublier qu'au moment de l'introduction de l'euro, en 1999, le cours était de 1,18. Et si l'on remonte plus loin encore, on constate qu'en 1996, un dollar valait 1,45 DM ou 4,80 F*, ce qui correspond à 1,35 dollar pour un euro. Donc, malgré un petit détour, l'euro est passé de 1,35 à 1,58** dollar en douze ans. Pas de quoi s'affoler - on en reparlera quand le cours sera à 2 dollars pour 1 euro, ce qui correspondrait à 1 mark ou 3,30 francs pour un dollar.***
* Jusqu'à l'introduction de l'euro, on exprimait le cours d'une monnaie étrangère dans sa propre monnaie (1 dollar = 4,80 francs). Cette méthode était courante dans le monde entier, sauf à Londres. Curieusement, en 1999, la zone euro s'est alignée sur l'Angleterre, bien que ce pays n'ait pas adopté la monnaie unique. Désormais la valeur de l'euro est exprimée en monnaie étrangère (1 euro = 1,58 dollars). C'est comme si, au lieu de dire que le litre d'essence vaut 1,30 euro ou le kilo de pommes 2 euros, on disait que l'euro vaut 0,77 l d'essence ou 0,5 kg de pommes - une façon de voir les choses absolument contre nature. Les gens qui ont pris une décision aussi stupide devaient être soûls ou drogués.
** En avril et en juillet 2008, le cours franchit pendant quelques minutes la barre de 1,60 mais redescend aussitôt. La spéculation en sens contraire le fait retomber à moins de 1,40 en septembre et à moins de 1,25 en octobre.
*** Pour la petite histoire : en 1984, le dollar cotait l'équivalent de 0,57 dollar pour un euro ; en 1978, l'équivalent de 1,10 ; dans les années 1960, l'équivalent de 0,48.
Dollar américain - Montagnes russes
(graphique simplifié ne tenant compte que des extrêmes)
Entre parenthèses :
Comment les Russes voient les rapports entre le dollar et l'euro
Une pub de Finance, le magazine moscovite qui vous explique comment faire de l'argent
Mauvais pour les exportations européennes, cette baisse du dollar, entend-on dire partout
En principe, oui. Mais ce que les Européens exportent vers les USA, ce ne sont pas des produits de première nécessité. Que le prix en dollars de la nouvelle BMW augmente de 10 ou 20 % ne gêne pas trop les acheteurs. Et puis les marges sont tellement lucratives, qu'il est toujours possible de faire une fleur à ses clients. D'un autre côté, l'appréciation de l'euro (ou du yen ou du franc suisse) devrait faire baisser les prix des marchandises achetées en dollars. Si les prix ne baissent pas, c'est que quelqu'un se remplit les poches à nos dépens. (Vous avez déjà vu les prix baisser ?...)
Curieusement, en septembre-octobre 2008, lorsque le dollar remonte ("bon pour nos exportations"), les exportateurs continuent de pleurnicher. Malgré la baisse des prix exprimés en dollars, les Américains n'achètent plus, paraît-il. C'est à cause de la crise, disent les exportateurs. (Ils n'en auraient pas profité pour augmenter leurs prix ?...)
[En mai 2010, le problème n'est plus le dollar mais l'euro. Le cours de la monnaie européenne a toutes les peines du monde à se maintenir au-dessus de 1,20 $.]
Le système monétaire international est-il en crise ?
On peut lire çà et là que le système monétaire international est lui aussi en crise et qu'il conviendrait de le réformer d'urgence. Le démocrate américain dissident Lyndon LaRouche, par exemple, est de cet avis, mais il est loin d'être le seul.
En fait, un tel système monétaire international impliquant, comme le dit Wikipédia, "une collaboration des principales économies mondiales afin de réguler les mouvements des taux de change entre les plus importantes devises", n'existe plus depuis des décennies.
Petit retour en arrière
Au 19ème siècle et à la "belle époque", chaque monnaie nationale est convertible en or et garantie par un stock de métal précieux détenu par la banque émettrice. C'est le régime de l'étalon-or. Les mouvements monétaires transfrontaliers, parfaitement libres partout, sont encore relativement limités en volume. Le gros des paiements résulte du commerce international, même si les transferts de capitaux purement financiers (investissements à l'étranger) sont également courants. Ce qui n'existe pas encore, c'est la frénésie spéculative sans rapport aucun avec l'économie réelle.
La guerre de 1914 met fin à cette situation idyllique (idyllique pour les privilégiés en mesure d'en profiter). Après un conflit coûteux et dévastateur, la plupart des pays se voient dans l'impossibilité de revenir au système de l'étalon-or, les quantités de métal précieux disponible ne suffisant plus à couvrir les dépenses de reconstruction. Les frontières restent fermées ; les monnaies perdent leur fonction internationale ; les Etats doivent réglementer le flux des paiements avec l'étranger. Bien entendu, tout le monde n'est pas touché de la même façon. Au contraire, les USA, véritables vainqueurs de la guerre, profitent largement de la situation. Mais face à des partenaires commerciaux insolvables, il leur est impossible d'en tirer tout le parti voulu. La crise aidant, rien ne change jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale.
En 1944-45, on retrouve en gros la même configuration qu'en 1918, mais fortement amplifiée : Etats-Unis vainqueurs, Allemagne effondrée, Europe occidentale très affaiblie, sans oublier le Japon détruit et l'Europe de l'Est exsangue. Les USA à eux seuls disposent d'un PIB égal à celui du reste du monde*. Il est donc évident qu'ils vont dicter leurs règles à la fois aux pays vaincus et à leurs propres alliés. Mais comme Franklin Roosevelt est encore à la Maison Blanche (jusqu'à sa mort, en avril 1945), c'est un capitalisme soft et social qui va s'imposer, d'autant plus que le camp communiste, en Europe (et pas seulement en Europe de l'Est), pèse de tout son poids dans la balance.
* Aujourd'hui, la part des USA est retombée à environ 27 % du PIB mondial (15 billions de dollars sur 54).
Les accords de Bretton Woods
En juillet 1944, les Etats-Unis organisent à Bretton Woods (dans le New Hampshire), une conférence internationale qui va régler les rapports monétaires de l'après-guerre. C'est l'économiste britannique Keynes, très influent auprès de l'administration Roosevelt, qui en a lancé l'idée. Au lieu d'abandonner à eux-mêmes les pays appauvris par la guerre, comme on l'avait fait en 1918, on va leur prêter l'argent qui leur permettra d'acheter en Amérique tout ce dont ils ont besoin pour redémarrer - ce qui stimulera d'autant l'économie des USA. C'est le crédit utile, et non cette forme de prêt qui tue, que l'on verra plus tard et dont aucun pays pauvre ne se remettra jamais.
La conférence de Bretton Woods s'inscrit dans le cadre de l'ONU nouvellement créée. Au centre du processus mis en place pour faciliter la reconstruction, on trouve la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, deux organismes qui ont entre-temps tout perdu de leur fonction initiale. En 2008, ils ne sont plus que des instruments de soumission, d'exploitation et de destruction au service de Wall Street. En 1945, leur rôle est encore d'aider le monde à se relever sans imposer outre mesure les vues américaines (du moins jusqu'à la guerre froide).
Dans le système de Bretton Woods, le dollar est la seule monnaie basée sur l'or. Une once de ce métal (31 grammes) vaut 35 dollars. Les banques centrales étrangères peuvent à tout moment convertir en or les avoirs qu'elles détiennent auprès de la Fed. En pratique, personne ne le fait, sauf la France de de Gaulle, en 1965, sur les conseils de l'économiste Jacques Rueff, qui rêve d'un retour à l'étalon-or d'avant 1914 (l'étalon est son dada).
Fort de cet avantage, le dollar devient en 1945 la seule monnaie utilisée dans les paiements internationaux. Les Etats-Unis, qui contrôlent 80 % des réserves d'or, sont aussi les banquiers de la planète, ce qui leur permet de renforcer leur hégémonie économique. La seule résistance qui leur sera opposée vient du bloc socialiste, qui refuse dès 1947 de se plier au diktat de Washington, puis à partir de 1958, de l'Europe occidentale en voie d'émancipation.
Avec le système de Bretton Woods des premières années, les USA fournissent les liquidités dont le commerce international a besoin. Ils le font soit directement, soit par le biais du FMI. Au fur et à mesure que les Etats d'Europe occidentale et le Japon se relèvent, les Américains leur délèguent une partie de cette tâche. Le système fonctionne sans problèmes et peut être qualifié de réussite.
L'après-Bretton Woods
A la fin de années 1960, le système a atteint ses limites. Les échanges internationaux (et le financement de la très coûteuse guerre du Viêt-Nam) nécessitent toujours plus de liquidités (dollars). Le stock d'or n'étant pas extensible, la devise américaine devrait, en bonne logique, être dévaluée. Mais le gouvernement américain s'y refuse. Sur les marchés, l'or se négocie déjà à plus de 35 dollars l'once : 40, 45, 50... Les experts les plus audacieux prédisent 70 dollars, le double du prix officiel (à comparer avec les 1.000 dollars de 2008). Les détenteurs de dollars perdent confiance. Des monnaies comme le mark et le yen commencent à faire concurrence au billet vert, mais leur valeur, comme celle de toutes les autres monnaies, se définit encore par rapport à lui.
En août 1971, les USA (Nixon est président) abandonnent la convertibilité. Bretton Woods est mort. A partir de là, les cours des devises vont se mettre à "flotter", parfois à l'intérieur d'une fourchette ou "serpent". Mais comme chaque fois que des pressions sont exercées sur une monnaie, le pays visé redéfinit la parité (au moyen d'une dévaluation ou d'une réévaluation), on a pratiquement affaire à un marché libre. Souvent, cependant, les gouvernements et les banques centrales ("indépendantes") soutiennent les cours en intervenant directement sur le marché des changes. C'est une question de choix politique, qui se pose avec ou sans parité rigide.
Durant les années 1970 et 80, beaucoup de pays industrialisés connaissent encore une certaine règlementation des changes. L'Etat contrôle plus ou moins les paiements avec l'étranger, par nécessité ou par principe. Puis, à partir de 1990, l'économie se mondialise, les barrières tombent. N'importe qui peut faire n'importe quoi (à condition d'en avoir les moyens). En 2008, seuls les Etats du tiers-monde imposent encore des restrictions à leurs citoyens (mais pas à leurs "élites" corrompues, ni aux "investisseurs" étrangers).
Pour un nouveau Bretton Woods ?
Comme la cause des problèmes financiers que nous vivons actuellement n'est pas de nature monétaire, on peut se demander en quoi une réorganisation serait utile. Si le dollar domine encore largement les marchés, ce n'est pas parce que les Etats-Unis l'exigent. Chacun est libre de ne pas investir aux USA, de ne pas acheter leurs bons du Trésor, de ne pas confier son argent aux banques de Wall Street, de facturer ses exportations en euros ou dans une autre devise. Une réforme du système monétaire n'apporterait rien de nouveau à cet égard.
Au contraire, on a l'impression que certains démagogues qui réclament aujourd'hui une nouvelle conférence monétaire internationale, veulent en réalité consolider la position du dollar, assez malmenée ces derniers temps, et fournir par la même occasion un ballon d'oxygène au système financier - pas au système monétaire, qui n'en a nul besoin. Dans un cas comme dans l'autre, le but de la manœuvre est de sauvegarder l'hégémonie économique américaine.
Ce qui, bien sûr, n'est pas l'objectif des réformateurs honnêtes, comme LaRouche - bien qu'un retour à l'ère de Bretton Woods implique aussi de replacer le dollar américain sur son ancien piédestal.
Une conférence purement monétaire ne servirait donc à rien. Une conférence financière sans chamboulement profond (voir plus haut), non plus.
"Nouveau Bretton Woods" : méfiez-vous des produits frelatés - pour LaRouche et ses partisans, le vrai Bretton Woods n'était pas tant financier et monétaire, qu'économique et politique.
Fin 2008, ce thème du nouveau Bretton Woods est tellement frelaté que même François Hollande et Michel Rocard, deux "socialistes" qui espèrent bien se retrouver en 2012 dans une "administration Strauss-Kahn", réclament "la remise à plat de tout le système financier et monétaire mondial, comme on le fit à Bretton Woods après la seconde guerre mondiale. Cela nous permettra de créer les outils d'une régulation mondiale que la globalisation et la mondialisation des échanges rendent indispensables". Indépendamment du fait que le système financier mondial n'a pas été réformé en 1945, on voit parfaitement où ces gens veulent en venir. Comme dans le cas de la taxe financière (taxe Tobin voulue par Attac), on constate que les idées "innovatrices" lancées par des milieux progressistes ou supposés tels, sont volontiers reprises en haut lieu. "La finance folle ne doit plus nous gouverner" ajoutent nos "réformateurs" - alors qu'ils savent pertinemment que la politique de leur idole DSK (patron du FMI) et la remise à plat qu'ils préconisent eux-mêmes ne font que renforcer l'emprise de la "finance folle" sur le monde.
Faut-il une monnaie unique à l'échelle mondiale ?
Depuis quelque temps, il en est de plus en plus souvent question. Mais c'est avant tout un argument utilisé par ceux qui estiment que la mondialisation peut très bien se passer des Etats-Unis et qu'elle s'en passera un jour. Beaucoup de partisans de l'idée de "gouvernement mondial", bien entendu totalement contrôlé par la mafia sioniste, vont dans ce sens (George Soros et Jacques Attali, pour ne citer qu'eux).
Curieusement, les dirigeants chinois soutiennent ce projet* qui ne peut que nuire à leur pays. Abandonner un dollar-monnaie d'échange sur lequel ils pourraient exercer une certaine influence s'ils le voulaient (ils sont un des principaux créanciers des USA) et adopter à la place un "globalo" qui les enchaînera à jamais aux maîtres du monde qui veulent leur perte, cela n'est pas seulement illogique, c'est totalement stupide et presque criminel.
Pour un pays post-souverain comme la France, ce genre de question ne se pose plus. Quel que soit le nom de la monnaie unique imposée par les fanatiques à la solde de l'étranger, le résultat sera le même.
* La Chine pourrait bien entendu utiliser sa propre monnaie dans les échanges internationaux. Mais cela en ferait automatiquement une monnaie de réserve. Les excédents commerciaux feraient grimper le cours du yuan, ce qui aurait pour effet de renchérir les produits exportés et de gripper le moteur de l'économie chinoise : c'est d'ailleurs ce que les Etats-Unis réclament depuis longtemps (ils parlent de "retour à l'équilibre"). De plus, une internationalisation du yuan exposerait la Chine aux excès de la spéculation monétaire, ce que les dirigeants veulent éviter à tout prix.
Mai 2011 - FMI, Strauss-Kahn, "réforme" du système monétaire international, droits de tirage spéciaux et bancor, ou les retombées inattendues d'une affaire criminelle : Les mésaventures du sioniste DSK et ce qu'en dit Thierry Meyssan.
Nostalgie
Un retour à l'étalon-or d'il y a un siècle est-il matériellement possible ?
Les réserves d'or mondiales des Etats représentent aujourd'hui quelque 50.000 tonnes, soit environ 1,6 milliard d'onces (les particuliers détiennent deux fois plus). Face à ces 50.000 tonnes, nous avons une masse monétaire mondiale estimée à 60 billions de dollars en 2008. Si chaque dollar (ou autre devise) en circulation devait être garanti par l'or, il faudrait fixer le prix de l'once à plus de 37.000 dollars. Un lingot d'un kilo vaudrait 1,2 million de dollars. De quoi foudroyer sur place de Gaulle et Jacques Rueff, s'ils étaient encore en vie... En ne prenant en compte que la monnaie fiduciaire (billets), soit environ 7 % de la masse monétaire totale en 2008, on aboutit à un prix théorique de 2.600 dollars l'once* pour un taux de couverture-or de 100 %. Mais un tel taux "idéal" n'existait déjà plus à la fin de l'ère de l'étalon-or.**
Quoi qu'il en soit, ces chiffres traduisent bien la forte dépréciation de la valeur intrinsèque du dollar (et des autres monnaies) par rapport à ce qu'elle était en 1945, dépréciation générée en grande partie par la libéralisation des marchés. Pour rétablir de façon viable un système basé sur l'or et revenir à un cours de l'once "acceptable", il serait nécessaire de suivre une politique brutalement déflationniste, qui non seulement éliminerait le secteur financier purement spéculatif, mais rétrécirait aussi l'économie réelle bien au-delà du supportable.
* Ce chiffre représente une estimation de 2008. Sachant que la masse monétaire croît beaucoup plus vite que la quantité d'or disponible, il augmente d'année en année. En 2011, il se situe probablement aux alentours de 3.400 dollars (le double du prix du marché).
** En 1913, selon l'économiste belgo-américain Robert Triffin, alors que la monnaie fiduciaire représentait 25 % de la masse monétaire totale, l'or (et accessoirement l'argent-métal) détenu par les banques centrales du monde entier couvrait à 68 % les billets de banque en circulation et à 17 % l'ensemble de la masse monétaire. Trente ans plus tôt, le taux de couverture était de 140 % et 62 % respectivement ; les billets de banque constituaient alors 44 % de la masse monétaire. Le bimétallisme (étalon-or et étalon-argent) était encore très répandu à cette époque. (Source : The Evolution of the International Monetary System - 1964.) Si l'on devait appliquer de nos jours un taux de couverture-or sembable à celui de 1913 pour la masse monétaire dans son ensemble, l'once d'or devrait valoir 6.300 dollars (base 2008) et probablement plus de 8.000 dollars en 2011.
Etalon-or ou pas, des mesures purement monétaires n'ont aucun sens sans modification radicale de tout le contexte. En 2008, le monétaire n'est que le reflet du financier, le banal symptôme d'un dérangement profond. Traiter les symptômes ne mène pas loin... A moins de redonner aux banques la fonction qu'elles avaient autrefois, de les encadrer très sévèrement, de sanctionner pénalement toute tentative d'abus et de supprimer tous les "produits" parasitaires, on ne pourra jamais mettre fin à la folie actuelle.
Taux d'intérêts
Depuis le début de la crise (été 2007), la Fed a fait passer son taux directeur (Federal Funds Rate) de 5,25 % à 2 % (30 avril 2008) puis à 1,5 (8 octobre 2008), à 1 % (29 octobre 2008) et enfin à 0,25 % (16 décembre 2008). La BCE et la Bank of England, dont les taux étaient inférieurs au taux américain en 2007, ont d'abord refusé de suivre la Fed*, rendant les placements en euros et en livres plus rémunérateurs. La baisse systématique des taux américains a contribué à la chute du dollar jusqu'en septembre 2008. Par la suite, l'alignement des pays européens sur Washington (toujours avec un certain délai) a fait remonter la monnaie américaine.
* En juillet 2008, la BCE décide au contraire de relever son taux directeur de 4 à 4,25 %. Elle finit par le ramener à 3,75 en octobre (la BoE baisse alors le sien à 4,5). Début novembre, nouvelle baisse à 3,25 pour la BCE et à 3 pour la BoE. Début décembre, baisse à 2,5 % (BCE) et à 2 % (BoE). En janvier 2009, nouvelle baisse du taux BoE à 1,5 (taux le plus bas depuis 1694) et du taux BCE à 2 %. En mars : baisse à 0,5 et 1,5 % respectivement. Début avril 2009, baisse du taux BCE à 1,25 ; début mai à 1 %. Deux ans plus tard, en avril 2011, le taux de la BCE remonte à 1,25 %, et en juillet à 1,5 %. Mais il redescend bien vite à 1,25 en novembre, puis à 1 % en décembre de la même année.
En temps normal, une baisse du taux directeur (le taux auquel la banque centrale approvisionne les banques) entraîne une baisse des autres taux et facilite l'octroi de crédits aux entreprises et aux particuliers, contribuant ainsi à relancer une économie défaillante. A partir de 2007, le problème résulte moins d'une véritable absence de liquidités que d'un manque général de confiance.
En pratique, il existe deux catégories, fondamentalement différentes, de taux d'intérêts pour les crédits : ceux - en baisse - que la banque centrale offre généreusement aux banques plus ou moins en difficulté, et ceux - constants ou en hausse - que ces mêmes banques appliquent à leurs clients emprunteurs. Ces deux catégories de taux n'évoluent pas en parallèle, la baisse décidée par la banque centrale n'est pas répercutée comme il se doit. On ne vient pas en aide aux débiteurs, mais aux banques.
Une baisse de taux est aussi, en principe, une excellente façon de doper la bourse, car il devient plus lucratif de détenir des actions que d'investir son argent dans des titres à revenu fixe ou de le placer en compte. Mais là aussi, la confiance fait défaut, et l'effet escompté n'est que de courte durée.
Fin 2008, le taux zéro devient une réalité aux Etats-Unis (pour les bons du Trésor à 3 mois).
Interventions de la Fed
Lorsque la confiance mutuelle que se portent les banques a disparu, et qu'aucune d'entre elles ne veut plus prêter d'argent à aucune autre (en supposant que des liquidités soient encore disponibles), le marché monétaire se trouve paralysé. Si la banque centrale n'intervient pas, le système bancaire s'effondre. Mais il risque aussi de s'effondrer en dépit des interventions, si la crise est plus profonde qu'il n'y paraît. Des centaines de milliards de dollars sont alors sacrifiés à perte. Quand la crise éclate, personne n'est en mesure de dire si le "sauvetage" va réussir. Après coup, tout le monde peut prétendre qu'il "savait".
On peut d'ailleurs se demander si le citoyen ordinaire et les patrons de la Fed entendent la même chose par "sauvetage". Sauver les débiteurs hypothécaires aux abois, les épargnants modestes et les petits actionnaires ne fait certainement pas partie du programme de Bernanke et de ses acolytes. Sauver les banques, peut-être, du moins certaines d'entre elles, celles où ces messieurs ont investi, et qui sortiront grandies et enrichies de l'épreuve. Depuis que le capitalisme existe, les crises ont toujours permis aux gros d'avaler les petits. Le mécanisme de concentration se trouve considérablement accéléré en temps de crise.
Mais pour en revenir à 2008, il est possible, dans un premier temps, que les centaines de milliards de dollars de la Fed ne servent qu'à accentuer la débâcle au lieu de la stopper, qu'ils soient en quelque sorte de l'huile jetée sur le feu. Bien entendu, ces concours sont remboursables à (très) court terme, mais comme le marché monétaire interbanques ne fonctionne plus, tout le monde se tourne vers la banque centrale. L'argent emprunté est remboursé à l'aide de nouveaux emprunts, qui sont ensuite renouvelés (et augmentés) d'échéance en échéance*. Le "court terme" devient du permanent en croissance continuelle. La Fed se trouve ainsi engagée dans un processus qui sort totalement du cadre habituel de ses opérations - même si son rôle est aussi de "prêter en dernier ressort".
* Fin septembre 2008, les banques américaines ont emprunté en moyenne, chaque jour, 368 milliards de dollars à la Fed.
Les aides au marché doivent bien sûr être comptabilisées et gonflent démesurément le bilan de la banque centrale américaine (1.770 milliards le 15 octobre 2008* contre 870 milliards un an plus tôt) avec - du moins en partie - des titres sans valeur et des crédits qui ne seront jamais remboursés. A moins que la situation ne se normalise, il faudra bien un jour ou l'autre remettre de l'ordre dans ce bilan, et soit tenir compte des dépréciations survenues, soit externaliser tous ces actifs "toxiques". Des sommes considérables resteront à la charge du contribuable - pour ce genre de choses, il y a toujours suffisamment d'argent. Et puis, comme dans le cas des dépenses militaires, l'argent n'est pas perdu pour tout le monde.
* 2.214 milliards le 13 novembre 2008 ; 2.385 le 8 décembre 2010.
Inflation
On considère généralement qu'une baisse des taux attise l'inflation*, car l'argent devient "moins cher", ce qui a tendance à accroître la masse monétaire. Il n'est pas certain cependant que l'inflation que l'on observe en 2007-2009 vienne de là. Les causes résident plutôt dans la spéculation qui fait grimper en flèche le prix du pétrole et des denrées alimentaires.
* Inversement, une hausse des taux, instrument classique utilisé pour "combattre l'inflation" et "calmer une économie qui s'emballe", produit souvent l'effet contraire en renchérissant la production et, partant, le coût de la vie. Les automatismes enseignés par les "experts" fonctionnent rarement dans le monde réel.
Inflation ou pas ?... En fait, il existe depuis quelque temps deux tendances parfaitement contradictoires en la matière. D'un côté, les "élites" économiques et financières s'efforcent d'instaurer une ambiance déflationnaire, semblable à celle des années 1930, où les taux d'intérêts versés aux épargnants, l'indice officiel des prix, les salaires et le pouvoir d'achat de la masse des citoyens sont en baisse. De l'autre, elles pratiquent - sans le crier sur les toits - une politique d'inflation effective qui se solde par des taux élevés pour les emprunteurs et une flambée des prix pour les consommateurs (énergie, alimentation, soins de santé). On arrive ainsi à faire coexister un taux directeur tendant vers 0 % et un taux d'inflation réelle (non-avoué) de 10 %.* Dans un monde où beaucoup d'indicateurs économiques sont systématiquement manipulés, cette contradiction passe presque inaperçue. C'est un moyen efficace pour faire baisser les salaires, accroître la pression sur le "marché du travail" et imposer des contre-réformes antisociales.
* En juin 2008, le taux officiel dans l'ensemble de la zone euro est de 4 % sur un an - ridicule... En mai 2009, encore mieux, on nous annonce un taux de 0,0 %, et en juillet 2009... -0,6 % !!!... En novembre 2009, alors que chacun peut constater de visu que les prix augmentent (produits alimentaires, énergie, etc.), Eurostat fait état d'une "baisse" de 0,1 %.
L'hédonisme a bon dos
Depuis quelques années, l'indice des prix est calculé selon la méthode américaine dite "hédoniste", qui part du principe que le consommateur est toujours à la recherche de ce qu'il y a de mieux sur le marché. Si la qualité d'un produit s'améliore d'une année sur l'autre mais que son prix reste constant ou augmente légèrement, les statisticiens considèrent que le prix a en fait baissé "à qualité constante". Cet hédonisme-là est bien sûr une absurdité, car il faut payer le prix demandé, que l'on veuille l'amélioration ou pas - on n'a pas le choix. Mais la méthode permet de maintenir le taux d'inflation officiel à un niveau nettement inférieur à l'augmentation réelle des prix.
Comment les statistiques sur l'inflation sont manipulées.
Croissance ou récession ?
Le taux de croissance, ou variation du PIB d'une année (ou d'un trimestre) sur l'autre, est considéré comme l'un des principaux indicateurs économiques d'un pays. Le PIB, ou produit intérieur brut, représente la somme des biens et services produits à l'intérieur du pays au cours de la période donnée. A l'instar de toutes les données statistiques (inflation, endettement, chômage, etc.), la valeur du PIB est en soi assez peu fiable. Elle l'est peut-être même encore moins que toutes les autres, car elle ne tient pas compte de nombreux facteurs (économie non-marchande, travail bénévole ou non-rémunéré, activités illicites ou clandestines) qui gagnent en importance d'année en année, au fur et à mesure que la situation économique réelle se dégrade et que la précarité s'étend.
Mais puisque les économistes partent du principe que la part occulte du PIB reste constante d'une année sur l'autre, le taux de croissance est considéré, lui, comme étant fiable. Ce qui reste à prouver... Si, pour prendre l'exemple français de 2006, le taux de croissance du PIB en valeur dite réelle (PIB brut corrigé de l'inflation) est de 2,2 % et que le taux d'inflation (officiel) s'élève à 1,5 %, tout est en ordre. Mais si l'inflation réelle a été, en fait, de 3 %, la croissance réelle n'est que de 0,7 %. Et si l'inflation réelle a atteint 4 ou 5 ou 10 %, alors la croissance réelle est négative. ("Croissance négative" est d'ailleurs une expression tout à fait sublime - un peu comme lorsqu'on dit "avoir négatif" en parlant du découvert sur son compte en banque.) Trafiquer le taux officiel d'inflation, c'est aussi trafiquer le taux de croissance - qu'on ne vienne pas nous raconter que la chose ne se produit pas (voir un peu plus haut).
A cela vient s'ajouter le fait que les services fantaisistes ou parasitaires enregistrés dans le PIB augmentent sensiblement depuis quelques années. Dans son Rapport pour la libération de la croissance (sic), présenté en février 2008, le sioniste sarkozyen "de gauche" Jacques Attali signale que "l'industrie financière [re-sic] croît depuis 2001 en Europe trois fois plus vite que le PIB". Pour ce qui est de l'hystérie climato-carbonique, elle doit contribuer, elle aussi, au gonflement artificiel de ce même PIB, mais là les chiffres ne sont pas connus.
L'utilisation systématique de termes comme "industrie" ou "produits" en relation avec la finance, a pour but de faire naître le sentiment qu'il s'agit d'une activité productive au même titre que, par exemple, l'industrie automobile ou la production alimentaire, alors que l'utilité du système financier pour l'économie réelle (rôle de "lubrifiant") est depuis longtemps écrasée par ses aspects nocifs et destructeurs.
Il existe en fait un véritable culte fétichiste de la croissance. Une économie doit absolument croître - peu importe de quelle façon, peu importe qu'il y ait des nuisances. Une armée de statisticiens fournit en permanence les indicateurs qu'on lui demande de produire afin d'alimenter ce culte, ce qui fait également grimper le PIB.
Dans son rapport, Attali écrit qu'"un point de croissance de plus signifie 500 euros de plus par ménage, par an, et 150.000 emplois supplémentaires". Poudre aux yeux, bien entendu. Comme s'il existait une répartition équitable des richesses produites, comme si la croissance ne profitait pas aux plus riches, comme si l'augmentation de la productivité n'était pas plus rapide que la croissance économique, comme si les emplois créés - quand ils le sont vraiment - n'étaient pas des emplois précaires. La majorité des nouveaux contrats de travail sont à durée déterminée. Les employeurs - y compris les plus "prestigieux", comme La Poste - n'hésitent pas à renouveler les CDD des dizaines, voire des centaines de fois, pour empêcher les salariés de participer à la croissance.
Le rapport Attali est une déclaration de guerre aux salariés, une exhortation à réaliser, plus vite, encore plus de contre-réformes (baptisées "réformes") et à démanteler toujours plus rapidement le secteur public au profit de la caste des prédateurs.
Alors, croissance (officielle) ou récession (officielle), le résultat est finalement le même pour la masse des citoyens. Les pays néo-capitalistes à fort taux de croissance, comme la Chine, sont les plus grands producteurs de misère et de pauvreté.
(En 2009, tous les pays occidentaux sont officiellement en récession. Les "experts" révisent leurs "prévisions" pratiquement chaque jour, en fonction des besoins de leurs employeurs ou commanditaires.)
La bourse
En mars 2008, malgré un net recul, la bourse ne s'est pas encore effondrée dans son ensemble. Lors du crash de 1929, le Dow-Jones perdit 40 % de sa valeur en une seule journée et continua de dégringoler pendant trois ans, passant de 300 points (maximum de 1929) à 41 points (minimum de 1932). Pour obtenir un effet équivalent, il faudrait une baisse subite de 5.000 points (de 12.000 à 7.000) en une journée, suivie d'une glissade ininterrompue jusqu'au niveau de 2.000 points en 2011. On n'en est pas encore là.
Soit dit en passant, au cours des dernières décennies, c'est surtout l'ascension de l'indice boursier américain qui a été spectaculaire : 1.000 points en 1972, 2.000 en 1987, 3.000 en 1991, 5.000 en 1995, 8.000 en 1997, 10.000 en 1999, 14.000 en juillet 2007. La plus forte chute enregistrée en une seule séance pendant cette période a été de 22 % (en 1987). Le record de la Grande Dépression attend d'être battu.
Au cours de l'année 2009, les centaines de milliards de dollars de fonds publics injectés dans les circuits financiers pour "sauver les banques" alimentent en fait une nouvelle vague de spéculation boursière. La politique des taux d'intérêts proches de zéro accentue ce mouvement. Le Dow-Jones remonte, faisant oublier la crise.
Février 2010 : Et si on fermait la Bourse pour relancer l'économie par Frédéric Lordon. "La Bourse finance les entreprises ? Au point où on en est, ce sont plutôt les entreprises qui financent la Bourse... Les capitaux levés par les entreprises sont devenus inférieurs aux volumes de cash pompés par les actionnaires, et la contribution nette des marchés d'actions au financement de l'économie est devenue négative (quasi nulle en France, mais colossalement négative aux Etats-Unis, notre modèle à tous)."
L'or et ses équivalents modernes
En mars 2008, l'once d'or (31 grammes) dépasse les 1.000 dollars* (en 1971, lorsque le dollar était encore indexé sur l'or, une once valait 35 dollars). Mais si la hausse des métaux précieux n'affecte pas trop la vie quotidienne, il en va autrement du pétrole et des céréales (voir un peu plus bas).
* En septembre 2008, le cours retombe à 750 dollars. En novembre 2009, il est proche de 1.200 dollars. Un an plus tard, il dépasse les 1.400 dollars. La barre des 1.500 dollars est franchie en avril 2011. En août de la même année, on frôle les 1.900 dollars.
Les réserves d'or des Etats
Fin 2007, les banques centrales détenaient un tiers de l'or de la planète, soit environ 50.000 tonnes. Les Etats-Unis en avaient 8.200 tonnes, le FMI 3.200, l'Allemagne 3.400, la France 2.700, l'Italie 2.500, la Suisse 1.200, etc...
Grâce au général de Gaulle (voir plus haut), l'or français est stocké dans les chambres fortes de la Banque de France, à 28 mètres de profondeur.
2.700 tonnes d'or (ou 218.000 lingots de 12,4 kg ou 400 onces) représentent un volume de 140 m3, soit un cube d'un peu plus de 5 mètres de côté.
Valeur de ces 87 millions d'onces en août 2011 :
environ 165 milliards de dollars ou 120 milliards d'euros,
soit moins de 8 % de la dette publique française.
L'Allemagne, elle, a "confié" ses réserves d'or à la Fed des Etats-Unis. Elles sont, paraît-il, conservées à Fort Knox, un camp militaire situé dans le Kentucky, mais en fait personne ne les a jamais vues, et personne ne peut prouver qu'elles existent encore physiquement. Cela vaut d'ailleurs également pour les réserves américaines. Le bruit court que Fort Knox est vide ; le gouvernement américain n'a jamais apporté de démenti convaincant.
Il ne faut pas être devin pour comprendre que, dans ces conditions, toutes les arnaques sont possibles. La Fed, dépositaire officielle de l'or, peut très bien vendre le métal précieux à l'insu du déposant, puisqu'elle sait qu'il n'en réclamera pratiquement jamais la restitution. La chose fonctionne à merveille aussi longtemps que la banque centrale allemande (ou une autre) se contente d'un morceau de papier ou d'une confirmation électronique attestant qu'elle "possède" l'or. C'est le principe de base de la "philosophie" bancaire. L'or, qui à l'origine était censé matérialiser et garantir la valeur de la monnaie virtuelle, devient lui-même virtuel.
Si la Fed ne se l'approprie pas effectivement, elle peut l'utiliser, sans que l'Etat étranger n'en sache rien, pour "garantir", également de façon virtuelle, ses propres opérations ou celles de tiers. L'or, qu'il soit physiquement présent ou pas, peut aussi "servir" plusieurs fois simultanément pour "rassurer" des créanciers de la Fed (ou de n'importe quelle banque) qui ne savent rien l'un de l'autre et qui, surtout, n'ont aucun rapport avec le propriétaire légal des lingots. Les "certificats 100 % or" qui circulent de par le monde représentent un volume bien supérieur à tout l'or physique qui les "garantit" (soi-disant). Tout cela ne fonctionne que dans la mesure où les titulaires de ces certificats ne réclament pas leur or tous en même temps. S'ils le faisaient, ils s'apercevraient bien vite que la fameuse "garantie" est sans valeur.
Pour l'or des banques centrales entreposé auprès de la Fed ou des banques de la City, la chose n'est pas très différente en principe. Lorsque le Venezuela a exigé la restitution de son or en août 2011 (voir plus bas), les dépositaires ont poussé des cris, proféré des menaces et pris des mesures de rétorsion. Où allons-nous si tout le monde se met à imiter de Gaulle et Chávez ?... (Le cas de la Libye, propriétaire de 140 tonnes d'or déposé à Londres, a été réglé en deux coups de cuillère à pot en mai 2011. Tout a été "confisqué", ce qui évite de rendre des comptes - pratique...)
Malgré tout cela, et même si un seul lingot de 12,4 kg vaut autant qu'une maison individuelle, les apparences sont trompeuses. Tout l'or des banques centrales, qu'il soit réel ou virtuel, "ne pèse pas lourd" en comparaison des sommes astronomiques manipulées et détournées par la finance internationale.
Le pétrole, les céréales et le reste
En janvier 2008, le cours du baril de pétrole (159 litres) atteint la barre des 100 dollars. En avril il est à 120 dollars, en mai à 135 (30 dollars cinq ans plus tôt). Le prix de l'essence atteint de nouveaux sommets. Les céréales connaissent une évolution tout aussi dramatique : en trois ans, le prix du blé et de l'orge augmente de 175 %, celui du maïs de près de 100 %.
La flambée des cours est purement spéculative en ce qui concerne le pétrole. Pour les céréales, elle est attisée en grande partie par l'hystérie climatique. Sous prétexte d'enrayer le réchauffement (une idée aberrante), une part toujours plus grande des céréales produites est utilisée pour fabriquer du carburant. Si les conséquences sont déjà graves dans les pays développés, elles sont catastrophiques pour le tiers-monde.
The Reason For Soaring Oil Prices par F. William Engdahl - Pourquoi les cours du pétrole s'envolent.
Lorsque le baril était à 128 dollars, on pouvait déjà dire que 60 % de ce prix étaient imputables à la spéculation des hedge funds, banques et groupes financiers opérant sur les marchés à terme de Londres et de New York, ou négociant de gré à gré pour ne pas attirer l'attention. (Et il ne s'agit là que du prix du brut, pas du prix du litre d'essence avec toutes ses taxes. Suivant le pays, la charge fiscale et la prime à la spéculation peuvent représenter ensemble jusqu'à 80 % du prix à la pompe.)
Selon les règles américaines, pour acheter du pétrole à terme, il suffit de disposer de 6 % de la valeur du contrat. L'effet de levier permet ainsi de se porter acquéreur de seize fois plus de pétrole qu'on ne le ferait en achetant au comptant. Comme tous les spéculateurs le font, il est évident que les cours montent, et montent, et montent... Cette évolution n'a rien à voir avec la demande de pétrole réel, puisque celle-ci est stagnante, voire en recul. Si les marchés étaient transparents et fonctionnaient véritablement selon la loi de l'offre et de la demande, les cours baisseraient dans la situation actuelle.
Dans un rapport commandé par le Sénat français en novembre 2005 et cité par Bruno Adrie sur le site de Michel Collon, il est dit que "depuis quelques années la part respective des différents marchés a considérablement évolué. Aujourd'hui, les transactions sur le marché physique représentent 165 millions de barils par jour ; celles sur le marché des futures, 500 millions de barils par jour et celles sur le marché des OTC (de gré à gré), 1 milliard de barils par jour. Les volumes d'échanges sur le marché papier sont désormais neuf fois plus importants que ceux sur le marché physique."
Les médias mettent l'explosion des marchés sur le compte du "pic pétrolier" (une supercherie au même titre que le "réchauffement" climatique) ou incriminent l'OPEP, les Arabes et les Chinois. Les véritables responsables ne sont jamais nommés.
Les géants de la finance manipulent les marchés et fixent les cours entre eux, à huis clos. Comme dans bien d'autres domaines, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank ou UBS sont étroitement mêlés à la spéculation. La bourse londonienne ICE Futures Exchange, numéro un mondial pour le pétrole, appartient à l'International Commodities Exchange d'Atlanta (Géorgie), une bourse fondée par Goldman Sachs. Et comme par hasard, Goldman Sachs gère le GSCI, l'indice le plus couramment utilisé pour les matières premières, dans lequel le pétrole est prédominant. Quand Goldman Sachs dit que le baril sera bientôt à 200 dollars, il faut comprendre : "Nous allons le faire grimper à 200 dollars."
Comment GS contrôle et manipule les instances gouvernementales américaines : Goldman Sachs - La grande machine à bulles - voir "Bulle n° 4 --- 4 $ le gallon".
Ne demandez surtout pas si Goldman Sachs est un groupe financier juif : 1) ce serait "antisémite" ; 2) il pourrait aussi bien s'agir de Lapons ou de Papous et 3) ce n'est tout de même pas leur faute s'ils comptent parmi les fondateurs de la Fed. Comme disait Jacques Attali (sioniste "de gauche") en 2002, dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent : "Les Juifs ont inventé le capitalisme... Ils ont toutes les raisons d'être fiers de cette partie de leur histoire."
L'objectif du Groupe de Bilderberg : le baril à 200$ par Paul Joseph Watson : "En promouvant les théories du pic pétrolier et en les combinant avec l'arnaque du réchauffement climatique causé par l'homme, Bilderberg cherche à augmenter les prix du pétrole jusqu'à ce que les standards de vie des classes moyennes ne puissent plus se maintenir, plongeant alors l'Occident dans le Quart-monde, pendant que les élites en récolteront les bénéfices financiers et politiques." (Bilderberg est un club oligarchique très fermé et très influent.)
Fin mai 2008, avec le baril à 135 dollars*, la démagogie bat son plein. Des députés démocrates américains proposent d'imposer aux spéculateurs l'obligation de prendre matériellement livraison du pétrole qu'ils achètent : la hausse serait stoppée instantanément. Or, le propre des marchés à terme, c'est justement qu'ils permettent d'acheter et de vendre des contrats sans se préoccuper des biens physiques qu'ils représentent. On achète des matières premières et on les revend avec profit sans jamais les avoir vues. Comme les démagogues du Congrès n'ont nullement l'intention de fermer les marchés à terme (ce serait du communisme, de l'antiaméricanisme et de l'antisémitisme), leur revendication est tout simplement de la poudre aux yeux.
* En juillet 2008, on frôle les 150 dollars. En septembre, on retombe à 100 ; en octobre, on repasse en dessous de 70 ; en novembre, en dessous de 50. Un an plus tard, en novembre 2009, le cours remonte à 80 dollars. En avril 2011, on est à plus de 110 dollars.
George Soros, multimilliardaire sioniste "de gauche" (lui aussi), enrichi grâce à la spéculation, découvre subitement qu'il existe une "bulle du pétrole". Quelle clairvoyance !... Encore un petit effort, et il nous expliquera que cette bulle est alimentée par les sommes astronomiques que la Fed a pompées dans les circuits financiers.
En Allemagne, des sociaux-démocrates en perte de vitesse essaient de récupérer quelques voix en demandant l'interdiction des transactions à terme sur le pétrole. Comme les bourses incriminées se trouvent toutes en dehors de leur pays, ils ne risquent pas grand-chose. Horst Köhler, le président de la République, déplore pour sa part que le capitalisme moderne soit devenu "monstrueux". C'est assez drôle d'entendre une chose pareille de la part d'un ancien patron du FMI - qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour se faire réélire l'année prochaine.
Et même Sarkozy, qui n'a probablement jamais fait lui-même le plein d'essence au cours des vingt dernières années, promet d'aider les Français les plus touchés par la crise du pétrole. Il va certainement faire de nouveaux cadeaux aux grosses entreprises de transport.
Début juin 2008, plusieurs ministres des finances de l'UE ont une idée géniale : "taxer davantage les bénéfices des groupes pétroliers" - pour que la nouvelle taxe soit aussitôt répercutée sur les prix.
(La hausse brutale des prix du pétrole a toujours été la conséquence de la spéculation et non d'une baisse de l'offre, même lors des deux "chocs" de 1973 et 1979. La guerre du Kippour et les mesures relativement modestes de l'OPEP, dans le premier cas, et la révolution iranienne, dans le second, n'ont été que les prétextes permettant aux géants de l'or noir et de la finance de s'enrichir démesurément.)
A découvrir aussi
- Qu’ont fait les banques des 1000 milliards d’euros qu’on leur a prêtés ?
- « Le Cartel des Banques a organisé toutes les crises économiques du monde ! »
- L'illusion démocratique
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres